Le défi pour les organisations syndicales est de trouver un équilibre entre la défense des intérêts matériels des travailleurs et la prise en compte des nouvelles formes d’engagement militant.

Il captive l’attention et suscite la controverse. Ce nouveau mouvement social, connu sous le nom de « wokisme », redéfinit depuis une dizaine d’années les contours de l’engagement militant et pose de nouvelles questions sur notre façon d’aborder les inégalités sociales. Cet article vous aide, avec objectivité, à bien comprendre ce phénomène et en déceler les implications pour la société, le syndicalisme et le monde du travail au 21e siècle.
Introduction
Le 3 octobre 2024, les dockers de la côte Est des États-Unis ont suspendu leur grève suite à l’intervention du gouvernement Biden dans la crainte d’une disruption majeure de l’approvisionnement du pays. Après un long préavis et trois jours effectifs de grève mettant plusieurs dizaines de ports américains à l’arrêt, l’International Longshoremen’s Association a ainsi obtenu une augmentation salariale de 62% sur six ans pour 47 000 travailleurs. Ce conflit social « à l’ancienne », opposant travailleurs et dirigeants, rappelle les luttes syndicales traditionnelles. Pourtant, depuis une dizaine d’années, les mouvements sociaux qui captent l’attention et mobilisent les institutions, y compris les syndicats, s’éloignent de ce modèle classique.
En effet, un nouveau phénomène a émergé, bouleversant le paysage de l’activisme : le mouvement « woke ». Cette lutte contre les discriminations, qui prône une vigilance sociale accrue pour débusquer les injustices, notamment au sein des systèmes de pouvoir, a pris une ampleur considérable. Depuis son émergence au début des années 2010 aux États-Unis sous la forme d’un corpus identifiable d’attitudes et de revendications, le « wokisme » suscite des débats passionnés et polarisés, tant outre-Atlantique qu’en Europe.
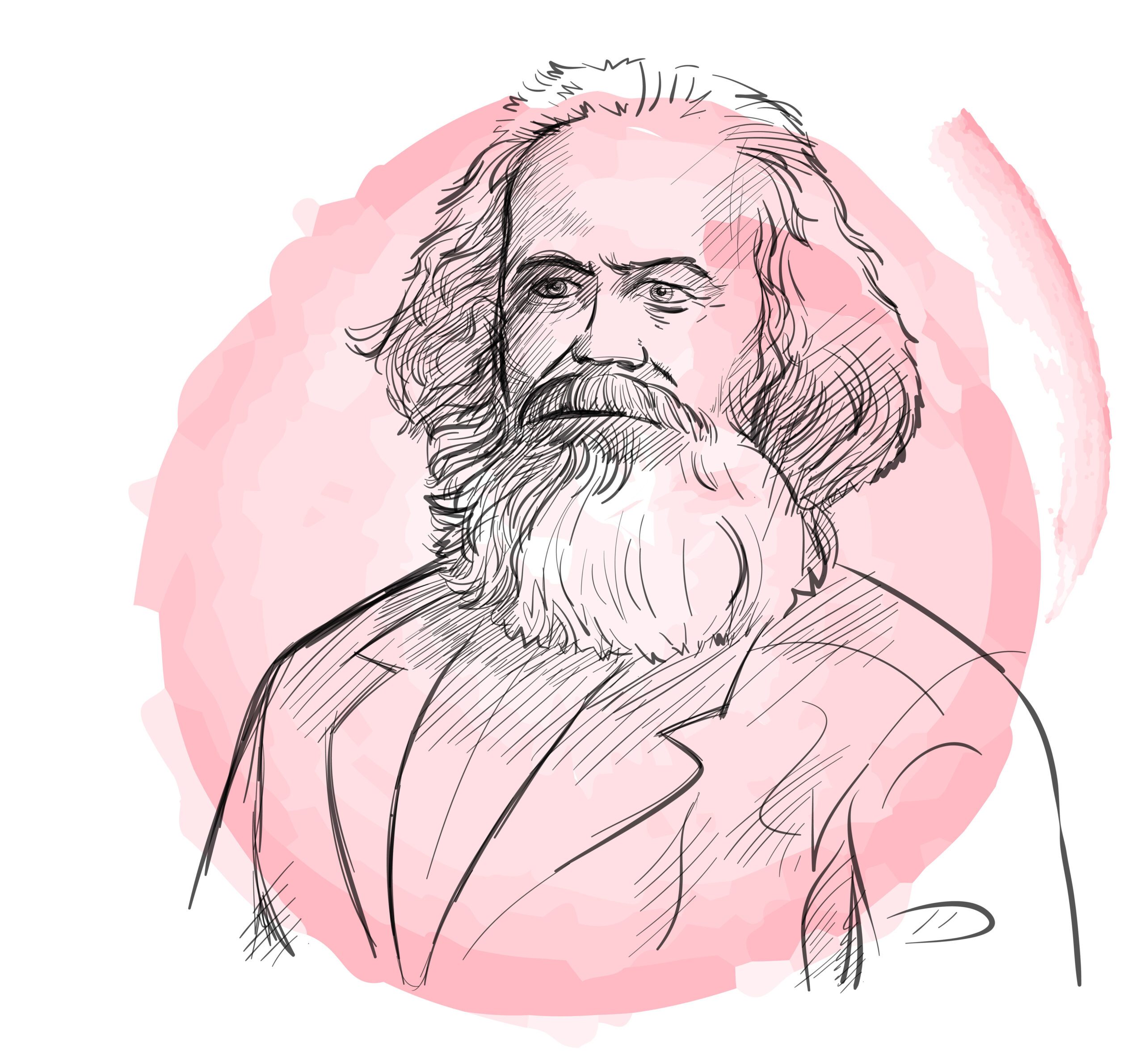
Le « wokisme » : racines philosophiques d’un mouvement social
Le « wokisme » est à la fois récent dans son expression, et peu nouveau dans ses idées. C’est d’ailleurs probablement l’une des raisons de son succès. Comment s’est-il développé au fil du temps ? Pour comprendre ce phénomène, il faut remonter aux sources de la pensée critique sur les inégalités sociales :
- Karl Marx (1818–1883), philosophe et économiste allemand, pose les bases de l’analyse des rapports de domination économique. Sa théorie selon laquelle la position économique détermine l’oppression et le rapport dominants/dominés est fondamentale pour comprendre le « wokisme ».
- L’École de Francfort, un courant de pensée fondé en 1923, opère un déplacement majeur de la focale marxiste des préoccupations économiques aux préoccupations sociétales et culturelles. Elle développe la théorie critique, une approche néo-marxiste qui analyse les structures sociales et culturelles. Ses penseurs, comme Theodor Adorno et Max Horkheimer, critiquent la culture de masse et l’industrie culturelle, qu’ils voient comme des outils de domination. Ils s’intéressent à la façon dont la culture et l’idéologie influencent la société, plutôt qu’aux seuls facteurs économiques. L’École de Francfort introduit le concept de « raison instrumentale », qui explique comment la rationalité moderne elle-même peut devenir un instrument d’oppression. Leurs idées ont profondément influencé les mouvements sociaux et intellectuels, notamment en remettant en question les structures de pouvoir existantes et en encourageant une analyse critique de la société. Cette approche a jeté les bases de nombreux mouvements critiques ultérieurs, y compris le « wokisme ».
- Antonio Gramsci (1891–1937), philosophe et homme politique italien, développe le concept d’hégémonie culturelle. Il argue que la classe dominante maintient son pouvoir non seulement par la force, mais aussi par le contrôle des institutions culturelles. Gramsci soutient que pour réaliser un changement social, il faut d’abord transformer la conscience collective en vue de résister à ce contrôle de la part des dominants. Il introduit l’idée de « guerre de position », une stratégie de changement social graduel à travers les institutions culturelles, par opposition à la « guerre de mouvement » révolutionnaire directe. Ses idées ont profondément influencé divers mouvements de gauche, en mettant l’accent sur l’importance de la culture et de l’éducation dans la lutte politique. Le concept d’hégémonie culturelle de Gramsci est devenu central dans de nombreuses analyses critiques contemporaines, y compris dans le mouvement « woke ». Cela explique pourquoi ce mouvement se focalise sur les pratiques culturelles des dominants et des dominés plus que sur les réalités politico-économiques des classes laborieuses.
- Frantz Fanon (1925–1961), psychiatre et essayiste martiniquais, introduit et développe l’idée gramscienne de la conscientisation dans une perspective anticoloniale et marxiste. Dans son ouvrage Peau noire, masques blancs (1952), Fanon argumente que la distinction raciale a été mise en place comme une superstructure bourgeoise pour renforcer l’oppression des peuples colonisés. La première responsabilité de la lutte sociale (mais aussi culturelle et économique) est donc d’opérer un travail de conscientisation des masses — tout particulièrement des opprimés —, à savoir les amener à comprendre cette superstructure qui explique leur oppression et leur donner ainsi les moyens indispensables de la renverser. La conscientisation devient le fer de lance d’une démarche révolutionnaire anticoloniale.
- Herbert Marcuse (1898–1979), philosophe et sociologue allemand associé à l’École de Francfort, développe une critique radicale de la société industrielle avancée. Dans L’Homme unidimensionnel (1964), il argumente que la société capitaliste moderne crée de faux besoins qui intègrent les individus dans le système existant de production et de consommation. Marcuse propose le concept de « Grand Refus », une opposition radicale à l’ordre établi. Il devient une figure influente des mouvements étudiants et de la Nouvelle Gauche dans les années 1960. Ses idées sur la libération des désirs réprimés et la critique de la « tolérance répressive » ont profondément marqué les mouvements de contre-culture. L’influence de Marcuse se retrouve dans de nombreux aspects du « wokisme », notamment dans sa critique des structures de pouvoir existantes et son appel à une transformation radicale de la société.
- Paulo Freire (1921-1997), pédagogue brésilien, développe un concept visant à construire l’éducation comme un processus de conscientisation et de libération. Dans Pédagogie des opprimés (1968), il développe l’idée que l’éducation ne doit pas être un outil de domination culturelle, mais un moyen pour l’apprenant de comprendre son quotidien et de prendre conscience des tenants de sa situation d’oppression. Freire reprend le concept de conscientisation proposé par Frantz Fanon et développe l’idée de l’éducation comme un processus de conscientisation et de libération. La conscientisation de l’oppression est alors présentée comme une véritable étape de transformation individuelle et sociale, suivie d’une action culturelle et sociale permanente en vue de l’émancipation (qu’on peut qualifier de militantisme au sens large du terme). Cette émancipation poursuit alors un objectif de transformation profonde de la société, bien au-delà du travail et de la consommation, dans le sens de la justice intégrale. Également théologien de la libération, son activisme, notamment en tant que consultant pédagogique auprès du Conseil œcuménique des Églises à Genève, lui permet de diffuser cette idée auprès de mouvements syndicaux catholiques et protestants. Les syndicats et tout mouvement militant peuvent donc participer à cette poursuite de l’émancipation en y incluant ses dimensions culturelle et sociétale.
- Henry Giroux (né en 1943), théoricien américain, élabore la pédagogie critique en s’appuyant sur les travaux de Freire. Il développe une théorie et une méthodologie de la pédagogie critique aux États-Unis, en les articulant avec les acquis de la théorie critique (développée par Marcuse et l’École de Francfort) et des études critiques en sciences sociales qui se penchent sur l’objectification et la marginalisation de catégories de la population réputées comme étant discriminées (Women’s Studies, Black Studies, Queer Studies, etc.). À partir des années 1970–1980, des programmes éducatifs (dont des formations militantes) sont diffusés sur les campus universitaires américains et dans certains mouvements d’émancipation tels que les Black Panthers ou le Gay Liberation Movement. Cette pensée et ces programmes se généralisent ensuite dans l’enseignement des sciences sociales et de l’éducation ainsi qu’à l’action sociale et politique, notamment aux politiques de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) des entreprises privées ou publiques, et plus récemment à l’enseignement en général (obligatoire et universitaire).
- Le concept de conscientisation en vue du militantisme est décliné dans les mouvements militants antiracistes, et particulièrement Black Lives Matter, qui investit efficacement sur les moyens de communication viraux que sont les réseaux sociaux. Plus spécifiquement, l’idée d’être « conscientisé » est désignée en argot afro-américain par « to be woke », qui signifie littéralement « être éveillé, alerte ». Ce terme est devenu un mème, d’où les termes de « pensée “woke” » ou « wokisme ». Il a été popularisé par le mouvement de justice interethnique, particulièrement par l’organisation Black Lives Matter autour des grandes manifestations de l’année 2013 aux États-Unis, notamment à travers la chanson « Master Teacher » d’Erykah Badu, dont le refrain « I Stay Woke » est devenu emblématique. Ainsi, le terme « woke » est-il devenu synonyme de conscience sociale.
L’impact du « wokisme » sur le paysage social et politique
Une nouvelle forme d’engagement militant
Le « wokisme » se distingue des mouvements sociaux traditionnels par son approche transversale et intersectionnelle des discriminations. Plutôt que de se concentrer sur une seule cause, il englobe un large éventail de luttes, allant de l’antiracisme au féminisme en passant par les droits LGBTQ+. Cette vision holistique des combats sociaux est au cœur même du mouvement.
Les thèses du « wokisme » visent une émancipation globale, cherchant à identifier et combattre les points communs entre différentes formes de domination. Les revendications du mouvement sont variées et touchent à de nombreux aspects de la société. Elles incluent l’utilisation d’un langage inclusif, particulièrement en ce qui concerne le genre des personnes, une remise en question critique des normes de genre, et la dénonciation de phénomènes tels que le « privilège blanc », la « culture du viol » ou le « racisme systémique ».
Le mouvement s’attache également à promouvoir une pensée « décoloniale » et à sensibiliser à la « racisation » des individus. Il s’intéresse aux problématiques liées à la « masculinité toxique » et soutient la « culture du bannissement » (cancel culture) comme moyen de responsabilisation sociale. En somme, le « wokisme » cherche à aborder les inégalités et les discriminations de manière interconnectée, reflétant la complexité des dynamiques sociales contemporaines. Cette approche transversale vise à identifier les points communs entre différentes formes de domination pour mieux les combattre.
Dans l’ensemble, ces thèses s’inscrivent dans un narratif global axé sur la justice sociale et la lutte contre les discriminations systémiques. Cette perspective postule que nous sommes toutes et tous impliqués, consciemment ou non, dans des systèmes d’injustice invisibles qu’il est impératif de combattre et de renverser activement. La pensée « woke » met l’accent sur la nécessité d’une vigilance constante pour identifier ces injustices, en particulier au sein des structures de pouvoir (comme les entreprises ou les services publics), et souligne notre responsabilité collective d’agir pour une société plus équitable. Ce mouvement prône un combat pour une justice intégrale, caractérisé par une quête permanente d’identification des injustices afin de mieux les combattre. L’objectif ultime est de se conformer progressivement à une conception spécifique de ce que devrait être une vie juste.

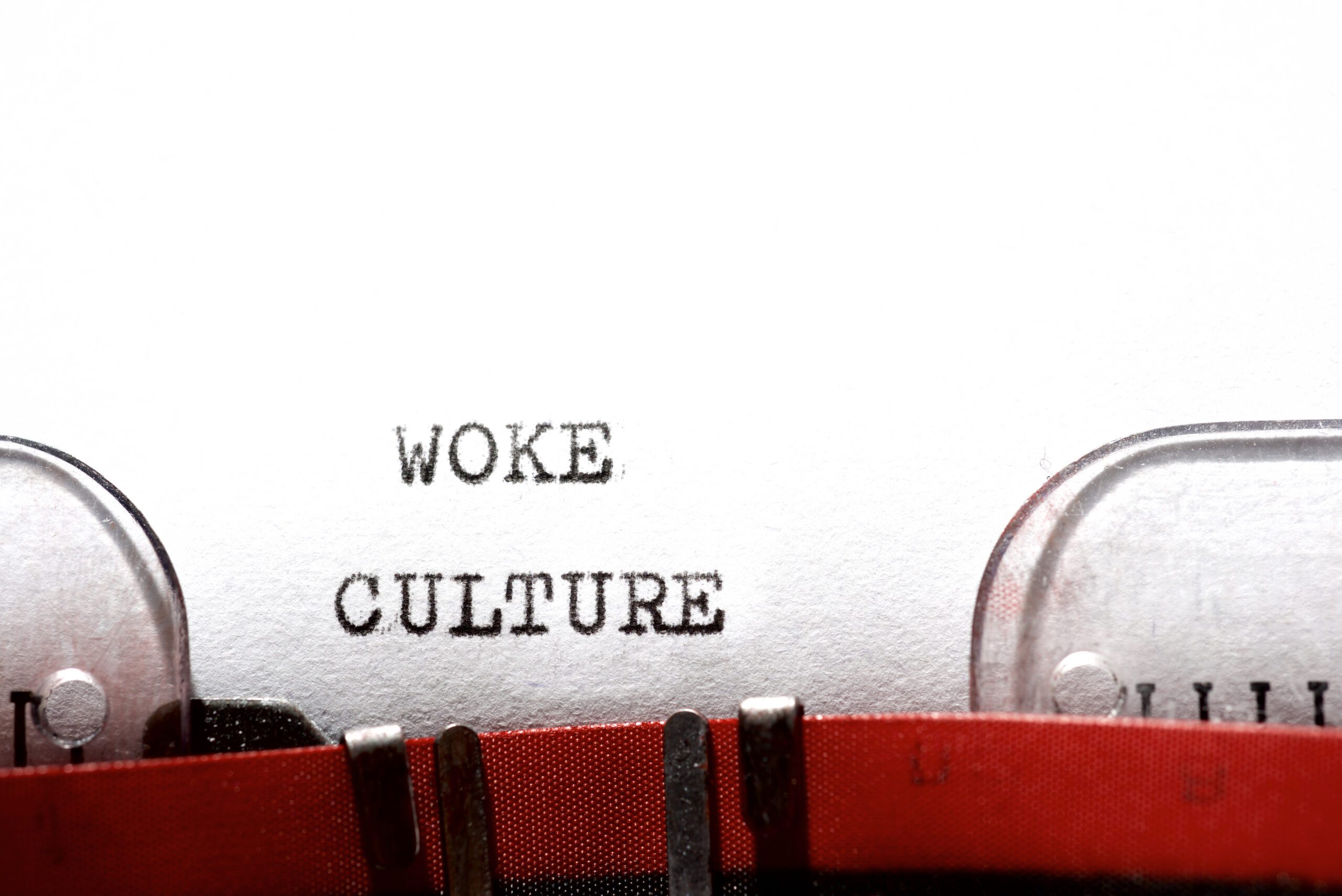
La réception large mais contrastée du « wokisme »
Au cours de la dernière décennie, le phénomène « woke » a connu une popularité et un intérêt croissants, tant en ligne que hors ligne, en Amérique du Nord, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Europe. En tant que système d’idées et mouvement social, cependant, il entraîne également une polarisation marquée. D’un côté, ses partisans y voient un outil indispensable pour combattre les injustices systémiques. De l’autre, ses détracteurs critiquent ce qu’ils perçoivent comme une forme d’extrémisme idéologique. Quelques faits et chiffres illustrent ceci :
- L’utilisation du terme « woke » sur Twitter a connu une augmentation spectaculaire, passant de quelques centaines de mentions en 2014 à plus de 100 000 mentions par jour en 2020. Cette explosion de l’usage du terme sur les réseaux sociaux reflète l’intérêt croissant pour le concept et les débats qu’il suscite.
- En France, une étude de l’IFOP réalisée en 2021 a révélé que seuls 14% des Français savaient ce qu’était la « pensée woke ». Ce chiffre, bien que relativement faible, indique néanmoins une pénétration significative du concept dans la société française, surtout compte tenu de son origine anglo-saxonne. L’adhésion aux thèses spécifiques de cette pensée citées plus haut reste pourtant très minoritaire dans la population française (11% à 19% en fonction des sujets), même si elles emportent souvent la majorité des Français voyant de quoi relèvent spécifiquement ces thèses.
- Au Royaume-Uni, une enquête menée par YouGov en juillet 2022 a montré que 57% des Britanniques savaient ce que signifie le terme « woke ». Pourtant, 73% des personnes qui utilisent le terme le faisaient dans un sens péjoratif. Ces chiffres soulignent la nature polarisante du phénomène, même dans un pays européen.
- Fin 2022, le mot « wokisme » a été ajouté au dictionnaire français Le Robert, témoignant de son intégration dans le langage courant et de son importance culturelle croissante.
- Aux États-Unis, le nombre de postes liés aux DEI (domaine largement défini par la pensée « woke ») a doublé en six ans au sein des grandes entreprises, passant de près de 6 000 postes en 2016 à près de 13 000 en 2022. Ce nombre décline légèrement depuis. De même, environ la moitié des 500 grandes sociétés cotées en bourse (S&P 500) lient désormais la rémunération des dirigeants d’entreprise à des cibles de performance en matière de diversité, bien que ce pourcentage ait baissé de 5 points au cours des deux dernières années.
Ces données illustrent l’ampleur de l’intérêt pour le phénomène « woke », qui s’est propagé des États-Unis vers l’Europe. Bien que son interprétation et sa réception varient considérablement, le concept a indéniablement pénétré le discours public et les débats sociétaux. L’intérêt pour le « wokisme » se manifeste non seulement en ligne, à travers les réseaux sociaux et les discussions sur Internet, mais aussi hors ligne, comme en témoignent les sondages d’opinion et son intégration dans les dictionnaires. Cette popularité croissante a également suscité des réactions diverses, allant de l’adhésion enthousiaste à une forte opposition, reflétant ainsi les divisions sociales et politiques actuelles.
Le « wokisme » comme réponse à une crise de sens
Une quête existentielle
Pourquoi le « wokisme » exerce-t-il une telle fascination ? L’émergence et le pouvoir captivant du phénomène « woke » témoignent d’une quête existentielle profonde. À la différence du militantisme d’accomplissement politique qui caractérise le syndicalisme classique, le « wokisme » trouve sa force dans un narratif qui offre une véritable conception du monde, répondant ainsi à des enjeux existentiels et à une crise de sens généralisée.
Comme expliqué plus haut, la pensée « woke » met l’accent sur la nécessité de reconnaître nos propres privilèges et biais, considérant que notre perception du réel est souvent faussée par notre position dans le système social. Le « wokisme » encourage à viser au-delà d’un simple militantisme d’accomplissement politique — comme l’a été la grève des dockers —, où la dénonciation des injustices et la lutte pour le changement sont vues comme des impératifs moraux. Cependant, cette focalisation sur la dénonciation sans mécanisme d’expiation peut conduire à une vision du monde où les rôles d’oppresseur et d’opprimé sont perçus comme immuables, rendant difficile toute réconciliation ou pardon.
Ce narratif remporte du succès dans un contexte de vide existentiel. John Vervaeke, professeur de psychologie cognitive à l’Université de Toronto, parle d’une « crise de sens » dans nos sociétés modernes. Selon lui, cette crise se manifeste par un sentiment croissant de déconnexion, d’aliénation et de perte de direction dans la vie. Le « wokisme », avec sa promesse d’éveil et de justice sociale, peut être vu comme une tentative de répondre à ce besoin profond de sens et de connexion. Vervaeke suggère que les mouvements sociaux comme le « wokisme » offrent une forme de « sens participatif », où les individus trouvent un but et une identité à travers leur engagement dans une cause collective.
Patrisse Cullors, co-fondatrice de Black Lives Matter, exprime cette dimension spirituelle : « Pour moi, la recherche de spiritualité était en grande partie liée au fait de chercher à comprendre mes propres conditions — comment ces conditions me façonnent dans ma vie quotidienne et comment je les comprends comme faisant partie d’un combat plus large, un combat pour ma vie ».

Une dimension quasi-religieuse ?
Le « wokisme » peut-il être considéré comme une forme de religion séculière ? Certains observateurs, comme l’historien Tom Holland, ont souligné les similitudes entre le « wokisme » et certaines formes de spiritualité. Dans son ouvrage Les Chrétiens (2019), Holland montre comment les fondements du « wokisme » comme lutte pour la justice se trouvent dans le christianisme et en reproduisent certains schémas. De façon plus polémique, l’analyse du mouvement « woke » par des auteurs européens, notamment en France (Jean-François Braunstein, Anne Toulouse), a eu tendance à assimiler globalement et péjorativement ce mouvement à une forme de religion expiatoire, de religion des élites en quête de supériorité morale ou encore de néo-puritanisme.
Cependant, cette comparaison avec la religion a ses limites. Frédéric Dejean, chercheur en sciences des religions à Montréal (Québec), met en garde. Il considère que comparer d’emblée le « wokisme » à une religion trahit une paresse intellectuelle et exonère l’observateur d’aborder avec finesse et empirisme ce phénomène. Cette réduction peut aussi surtout jouer un rôle rhétorique, où la comparaison avec la religion sert surtout à dénoncer et condamner plutôt qu’à informer ou à expliquer. Une comparaison un pour un serait donc erronée.

Le « wokisme » et le monde du travail : un défi pour le syndicalisme ?
Tension entre tradition et modernité
Le mouvement « woke » pose la question du devenir de la représentation des droits des travailleurs. Existe-t-il une tension entre le travail syndical traditionnel et les combats poursuivis par la pensée « woke » ? Ce nouveau paradigme militant ne risque-t-il pas d’éclipser des enjeux fondamentaux liés au travail à l’ère contemporaine, comme l’automatisation avancée assistée par l’intelligence artificielle ?
L’automatisation avancée : un enjeu crucial pour le monde du travail au 21e siècle
L’automatisation avancée et l’intelligence artificielle représentent en effet un défi majeur pour le monde du travail au 21e siècle, touchant de nombreux secteurs, aussi bien les métiers manuels que les professions intellectuelles, aussi bien le secteur privé que la fonction et les services publics. Selon un rapport du McKinsey Global Institute, jusqu’à 800 millions d’emplois pourraient effectivement être automatisés d’ici 2030. Cette transformation radicale du marché du travail soulève des questions cruciales sur l’avenir de l’emploi, la formation continue et la protection des travailleurs. Voilà donc des questions qui devraient a priori être d’un intérêt de premier ordre pour les mouvements syndicaux.
La grève des dockers de 2024 illustre parfaitement l’importance de ces enjeux. L’un des points de contentieux majeurs était précisément la question de l’automatisation des ports. Les dockers craignaient que l’introduction de nouvelles technologies ne menace leurs emplois et leurs conditions de travail. Cette lutte met en lumière l’utilité persistante du syndicalisme « à l’ancienne » face aux défis contemporains.
En effet, le syndicalisme traditionnel, avec sa capacité à mobiliser les travailleurs et à négocier collectivement, reste un outil puissant pour défendre les intérêts des employés face à ces transformations technologiques. La grève des dockers a abouti à une augmentation salariale significative de 62% sur six ans, démontrant l’efficacité de l’action syndicale collective.
Le risque d’un terrain délaissé
Le gain de popularité des mouvements populistes, tant à gauche qu’à droite, parmi les classes laborieuses des deux côtés de l’Atlantique, n’est-il pas le signe qu’un terrain est délaissé par les structures plus établies, syndicats et partis politiques inclus ?
Ce vide laissé par les institutions traditionnelles est de plus en plus comblé par des mouvements populistes. Aux États-Unis, par exemple, le soutien des cols bleus à Donald Trump lors des élections de 2016 et 2020 peut être interprété comme une réaction à ce qu’ils perçoivent comme un abandon de leurs préoccupations économiques par les élites politiques et syndicales.
En Europe, on observe une tendance similaire avec la montée de partis populistes de droite qui capitalisent sur le mécontentement économique des classes laborieuses ou des classes moyennes en crainte de déclassement. En France, par exemple, le Rassemblement national, parti d’extrême droite, a réussi à attirer une part importante de l’électorat ouvrier traditionnellement de gauche.
Ces changements mettent en lumière un défi crucial pour les syndicats et les partis politiques traditionnels. Ils doivent désormais concilier deux impératifs : rester attentifs aux préoccupations économiques concrètes des travailleurs, particulièrement face aux bouleversements technologiques, tout en intégrant les questions d’équité et de justice sociale portées par le mouvement « woke ».
Dans ce contexte, un nouveau discours politique semble émerger, critiquant un capitalisme de « laisser-faire » dépourvu de cadre éthique et pointant du doigt ses effets destructeurs sur les classes laborieuses. La nomination de J. D. Vance, sénateur et écrivain issu de la classe défavorisée blanche américaine, comme colistier de Donald Trump pour la vice-présidence des États-Unis, illustre cette tendance. Elle révèle une sensibilité croissante, même au sein de la droite américaine traditionnellement pro-entreprise, aux conséquences sociales d’un capitalisme débridé.
Cette évolution reflète une prise de conscience des effets néfastes des transformations du marché du travail, largement induites par les avancées technologiques. Ces changements engendrent non seulement des pertes d’emplois, mais aussi une détérioration de la santé mentale et une crise de sens chez de nombreux travailleurs. L’ampleur de ces impacts se fait désormais sentir sur la scène politique, soulignant l’urgence d’un cadre moral centré sur la préservation de l’humain, des familles et communautés, de la cohésion sociale et de l’environnement pour encadrer les pratiques des entreprises et préserver le tissu social.
Aujourd’hui comme par le passé, l’évolution du capitalisme continue d’avoir un impact profond sur l’économie et la vie quotidienne des travailleurs. Si ce système offre des opportunités d’entreprendre, d’innover et de créer de la richesse, il engendre également des procédures déshumanisantes et des manipulations visant à faire accepter certains de ses effets les plus néfastes.
Plus préoccupant encore, certaines thèses et revendications de la pensée « woke » ont été récupérées par des acteurs économiques et managériaux publics ou privés, notamment à travers les politiques de responsabilité sociétale des entreprises ou DEI. Paradoxalement, cette récupération a souvent pour effet de renforcer le statu quo plutôt que d’améliorer réellement les conditions des travailleurs ou de l’environnement.
Ce phénomène a donné naissance à ce que l’historienne française des processus de production Audrey Millet appelle un « marché de la vertu », où les entreprises utilisent une image éthique de façade pour attirer ou fidéliser les consommateurs ou les usagers, sans pour autant promouvoir de véritables valeurs sociales. Face à ces dérives, il apparaît crucial de créer un cadre éthique solide autour du capitalisme, capable de contrer ses excès tout en préservant ses aspects positifs.
La popularité croissante de la pensée « woke » risque de détourner l’attention des syndicats et des partis politiques traditionnels des préoccupations économiques concrètes des travailleurs. Alors que le « wokisme » se concentre sur les questions certes importantes d’identité et de discrimination, des enjeux cruciaux comme l’automatisation avancée, la précarisation de l’emploi, la perte de sens ou l’érosion des droits du travail pourraient être négligés.
Défi au sein des institutions publiques
Pour terminer, le retour de bâton à l’égard du développement des thèses « woke » au sein des institutions publiques aux États-Unis ces dernières années mérite notre attention. Leur mise en œuvre au moyen des pratiques DEI dans les secteurs publics de l’enseignement et de la jeunesse ainsi que de l’enseignement supérieur (écoles, universités, bibliothèques et centres de formation) a engendré une vague de contestations et de mesures punitives. Certaines parties prenantes, y compris des usagers des services publics, des fonctionnaires et des élus, ont même cherché à réduire le financement de ces institutions.
Ces défis sont multiples et complexes. Ils concernent notamment des cas de censure et d’autocensure dans l’enseignement et la formation continue, souvent liés à des objections d’opinion ou de conscience vis-à-vis de certaines thèses « woke ». S’y ajoutent des questions éthiques sur l’utilisation non biaisée de l’intelligence artificielle dans la recherche et la formation, ainsi que des débats sur la liberté d’expression personnelle en milieu professionnel.
La liberté académique, avec ses droits et responsabilités, est également au cœur de ces controverses. Enfin, l’utilisation, parfois abusive, de codes de civilité ou de conduite sur le lieu du travail soulève des interrogations sur les limites de la liberté d’expression dans le cadre des institutions publiques. Ces enjeux reflètent les tensions croissantes entre les nouvelles sensibilités sociales portées par le « wokisme » et les traditions académiques et professionnelles établies dans le secteur public.
Conclusion :
les leçons pour le syndicalisme et l’engagement citoyen
Face à l’émergence du « wokisme », le syndicalisme est appelé à se réinventer. Comment articuler les actions syndicales traditionnelles avec les besoins existentiels de notre modernité avancée ? Le défi pour les organisations syndicales est de trouver un équilibre entre la défense des intérêts matériels des travailleurs et la prise en compte des nouvelles formes d’engagement militant.
En fin de compte, le phénomène « woke » nous invite à repenser nos modes d’action collective et notre conception de la justice sociale. Qu’on l’approuve ou qu’on le critique, il est indéniable que ce mouvement a profondément marqué le paysage militant contemporain, ouvrant de nouvelles perspectives pour l’engagement citoyen et la lutte contre les discriminations.
Le « wokisme » est-il une réponse adéquate aux défis de notre époque ? Ou n’est-il qu’une étape dans l’évolution constante des mouvements sociaux ? Seul l’avenir nous le dira, mais une chose est sûre : il a déjà changé la façon dont nous pensons et parlons des injustices sociales.
Sources :
(Sans nom), (19 septembre 2024). “America is becoming less ‘woke’”. The Economist, en ligne: https://www.economist.com/briefing/2024/09/19/america-is-becoming-less-woke.
Bossaller, Jenny et Toni Samek (2023). “The Contested Nature of the Public in Policy: Implications for Educators”. Proceedings of the Association for Library and Information Science Education Annual Conference 2023, DOI: https://doi.org/10.21900/j.alise.2023.1360.
Cullors, Patrisse (24 juin 2015), citée par Hebah G. Farrag, “The Role of Spirit in the #BlackLivesMatter Movement: A Conversation with Activist and Artist Patrisse Cullors”. Religion Dispatches, en ligne : https://religiondispatches.org/the-role-of-spirit-in-the-blacklivesmatter-movement-a-conversation-with-activist-and-artist-patrisse-cullors/.
Dejean, Frédéric (8 novembre 2022). « L’analogie religieuse dans la critique du wokisme ». La Vie des Idées, en ligne : https://laviedesidees.fr/L-analogie-religieuse-dans-la-critique-du-wokisme.html.
Duncan, Ian, David J. Lynch et Lauren Kaori Gurley (3 octobre 2024). “Dockworkers union suspends strike; ports reopen on East and Gulf coasts”. The Washington Post.
Eatwell, R., & Goodwin, M. (2018). National Populism: The Revolt Against Liberal Democracy. Penguin UK.
Fourquet, Jérôme et Gautier Jardon (février 2021). « Notoriété et adhésion aux thèses de la pensée “woke” parmi les Français ». Sondage disponible sur le site Groupe IFOP, en ligne : https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2021/03/117936-R%C3%A9sultats.pdf.
Long, Heather (1er octobre 2024). “Opinion: The real reason 47,000 dockworkers are on strike”. The Washington Post.
McKinsey Global Institute (2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation.
Millet, Audrey (2023). Woke washing. Capitalisme, consumérisme, opportunisme. Paris : Les Pérégrines, pp. 25–26, 59–60, 179.
Pew Research Center (2018). The 2018 Midterm Vote: Divisions by Race, Gender, Education.
Smith, Matthew (26 septembre 2022). “Most Britons now know what ‘woke’ is”. YouGov UK, en ligne : https://yougov.co.uk/politics/articles/43645-most-britons-now-know-what-woke.
Vervaeke, John (2019). “Awakening from the Meaning Crisis”. Série disponible sur YouTube.

Christel Lamère NGNAMBI
A PROPOS DE L’AUTEUR
Christel Lamère Ngnambi est auteur, conférencier et formateur établi à Bruxelles (Belgique). Il est consultant en communication stratégique et communication politique.