Des victimes de l’incurie de l’administration découvrent, parfois avec un grand retard, la spoliation qu’ils ont subie. Les institutions doivent payer !
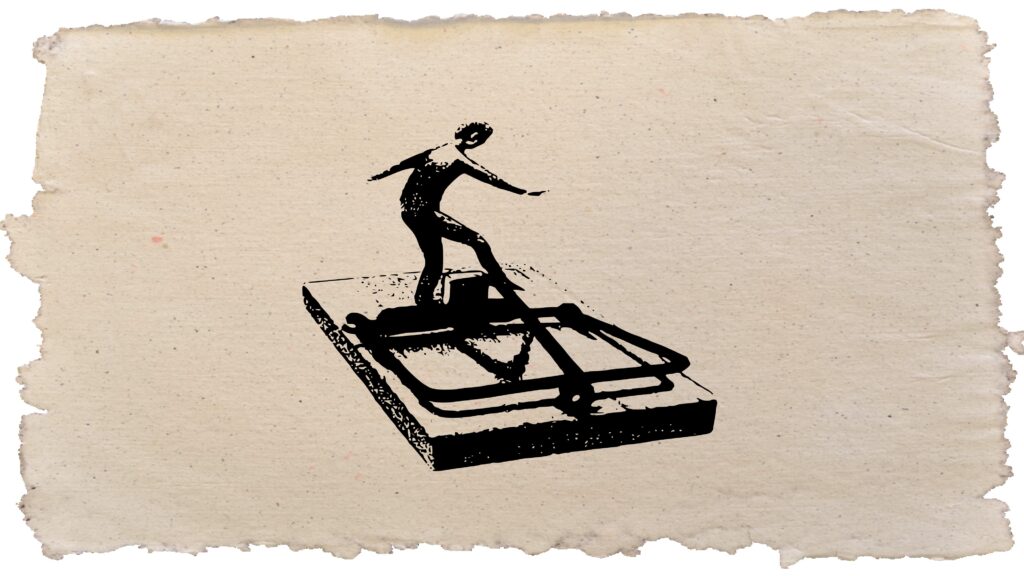
La pension d’ancienneté est une des branches de la Sécurité sociale, qui vise à permettre aux gens de récolter les fruits de leur travail une fois qu’ils ne seront plus en activité. En guise de « filet de sécurité », elle comporte aussi un mécanisme conçu pour garantir, le cas échéant, une pension meilleure que celle calculée sur le parcours de carrière du travailleur et visant à prémunir les plus faibles contre le risque de se retrouver dans le besoin : il s’agit de la règle du minimum vital.
Le régime de pensions des institutions de l’UE (RPIUE) trouve sa base juridique dans le statut des fonctionnaires. Pour la pension d’ancienneté, la porte d’entrée incontournable est l’article 77 du statut. Celui-ci prévoit deux modes alternatifs de calcul de la pension :
- l’un (2e alinéa) fondé sur l’accumulation des annuités (y compris celles provenant d’un transfert) et le dernier traitement de base ;
- l’autre (4e alinéa), avec comme unique variable les années de service :
4% x [minimum vital] x [années de service], le minimum vital étant défini comme le traitement de base d’un AST 1/1.
Les deux calculs seront faits obligatoirement lors de la liquidation des droits à pension en vue de la mise à la retraite, même si le 4e alinéa affecte seulement les bas salaires et les courtes carrières AST. C’est le meilleur des deux résultats qui définira le montant de la pension.
Or, au moment critique, où l’intéressé doit décider de transférer ou pas ses droits acquis sous un régime national vers le RPIUE, l’article 77 a été contourné ! Son 4e alinéa a été perdu de vue. Transférer ou pas est une « faculté » que le statut réserve à l’intéressé. Or, l’administration s’est placée uniquement dans l’hypothèse du 2e alinéa en atterrissant directement sur les modalités du transfert. Dans certains cas, elle a même explicitement conseillé le transfert. Ce qui a entraîné illico la perte de la pension nationale.
Ici commence le calvaire pour tous ceux qui n’ont pas été informés en temps utile par le service compétent de l’existence de la règle du minimum vital. « En temps utile » signifie : avant de signer « pour accord » la proposition de transfert IN qui leur était adressée par l’administration.
Le nouvel arrivant, souvent d’un niveau d’enseignement modeste dans les cas qui nous intéressent, aurait dû connaître le statut, contrairement aux fonctionnaires du service compétent, qui, sous le poids de leur charge de travail, n’ont pas … trouvé le temps de les informer de l’existence même de la règle du minimum vital.
Comme si l’ignorance de l’existence de la règle du minimum vital ne suffisait pas, le libellé des lettres officielles de l’administration venait enfoncer le clou de la confusion : « la bonification en annuités de pension à laquelle ce transfert vous donnerait droit » ou encore : « Ces annuités de pension seront portées au crédit de votre compte auprès du régime de pension de l’Union ».
Le lecteur de ces lettres pouvait-il en déduire que cette « bonification » a existé au moment du transfert, sans aucune garantie qu’elle se reflétera aussi sur sa pension au moment de sa liquidation ? En réalité, il existe bien des « annuités bonifiées » (à l’entrée) « non prises en compte » (lors de la liquidation).
Il s’agit d’un cas flagrant de faute de service et d’engagement de la responsabilité de l’Union : un chemin semé d’embûches procédurales et déshonorant pour l’institution. La recherche de remèdes s’est néanmoins orientée vers une voie de recours – en théorie du moins – non conflictuelle et non liée à une illégalité ou à une faute dans le comportement de l’institution, mais à l’idée que l’Union s’est enrichie sans cause au détriment du patrimoine de celui qui a transféré. À savoir que, puisque l’Union s’était approprié le capital que les intéressés avaient transféré IN sans fournir de contre-prestation, elle devait restituer ce capital.
La jurisprudence en la matière a connu une éclaircie, pour se replonger immédiatement après dans le noir.
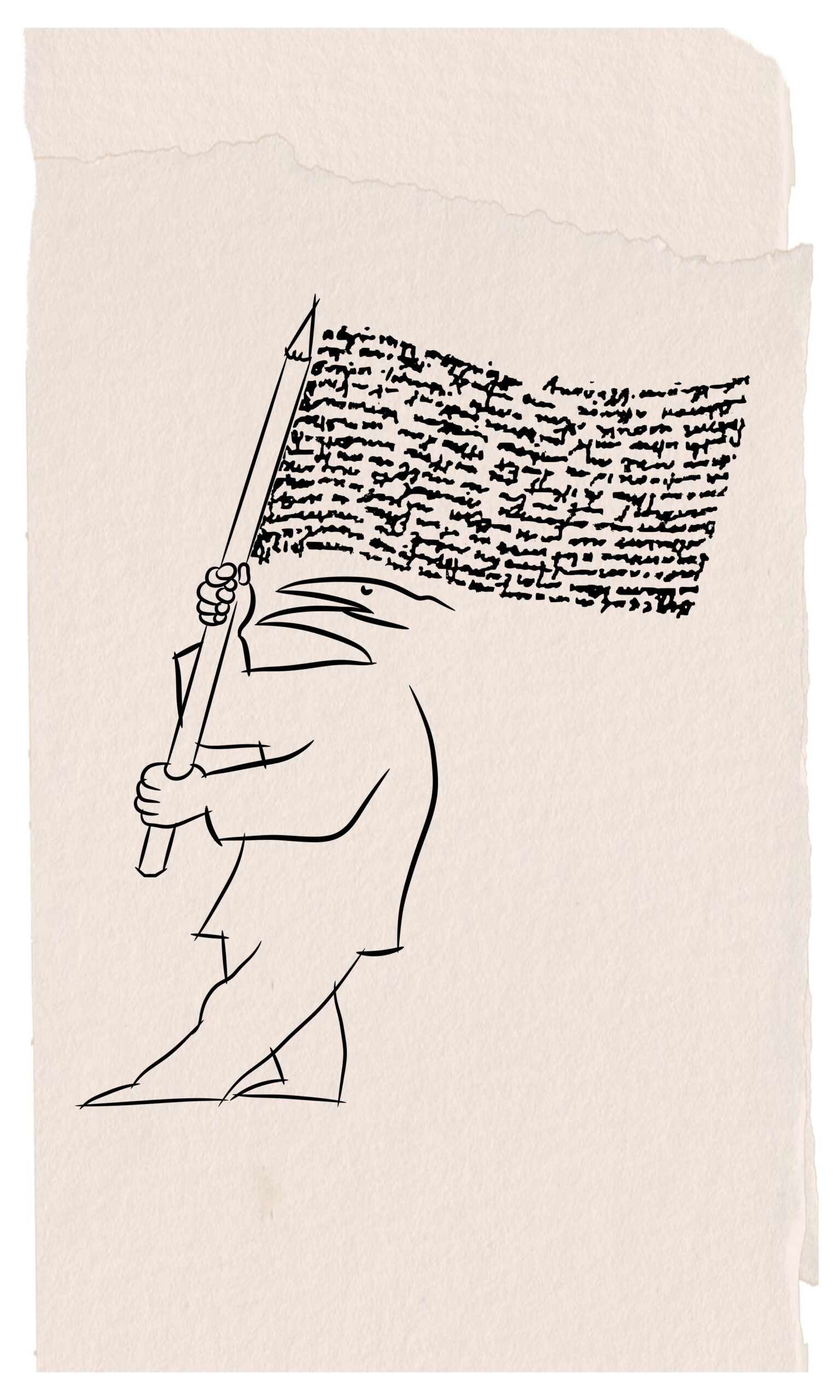
L’arrêt Barroso Truta, un grand bond en avant, resté isolé
Dans notre publication Transfert des droits à pension : explications du 8 janvier 2019, nous avons présenté l’évolution jusqu’à l’arrêt du Tribunal (chambre des pourvois) du 18 septembre 2018, affaire T-702/16 P, Barroso Truta e.a. / Cour de justice.
Un arrêt de principe, un arrêt qui a défriché le terrain. Hélas ! le terrain défriché est retombé par la suite en friche.
Deux philosophies diamétralement opposées
Pour comprendre la nature de cette saga judiciaire, il faut remonter aux principes et aux valeurs qui sous-tendent les deux tendances en présence.
A. Une filière de la jurisprudence converge dans le sens de garantir que les droits à pension acquis tout au long du parcours professionnel, dans le système de l’UE et dans des régimes nationaux, de la personne se reflètent dans sa (ou ses) pension(s).
- Le système de transfert des droits à pension a été instauré en faveur des fonctionnaires ou agents, afin de garantir ainsi à l’UE les meilleures possibilités de choix d’un personnel qualifié (arrêt Commission / Belgique, 137/80). Un transfert voué à se retourner en défaveur de l’intéressé est contraire à la finalité du système.
- En l’absence de transfert, les années de travail accomplies dans une institution européenne sont ajoutées aux annuités acquises dans un régime national, afin d’ouvrir le droit à une pension nationale, qui sera calculée au prorata de la période d’affiliation au régime national (arrêt My / ONP, C-293/03, ordonnance Ricci et Pisaneschi /INPS, C 286/09a.). Donc, les annuités non transférées ne sont jamais perdues.
- Dans l’arrêt Kristensen / Conseil, aff. jointes T-103/98 e.a., étant donné que les annuités bonifiées lors d’un transfert IN ont été plafonnées sur la période d’affiliation effective, la partie du capital non bonifiée devait être reversée à l’intéressé sous forme d’excédent pécuniaire. À la différence de cette affaire, où l’enrichissement sans cause en faveur de l’Union est immédiatement quantifié et remboursé, dans les affaires Barroso Truta et suivantes, l’enrichissement ne peut être quantifié avec précision que lors de la liquidation des droits à pension de l’intéressé. En réalité, un simple décalage dans le timing.
La règle instaurée par l’arrêt Kristensen, fondée sur le principe commun aux ordres juridiques des États membres d’interdiction de l’enrichissement sans cause, qui est applicable même sans être prévu aux traités, s’est par la suite cristallisée dans les Dispositions générales d’exécution (DGE) des institutions. L’arrêt Barroso Truta a suggéré qu’une disposition dans le même esprit soit adoptée pour couvrir des cas comme ceux en litige.
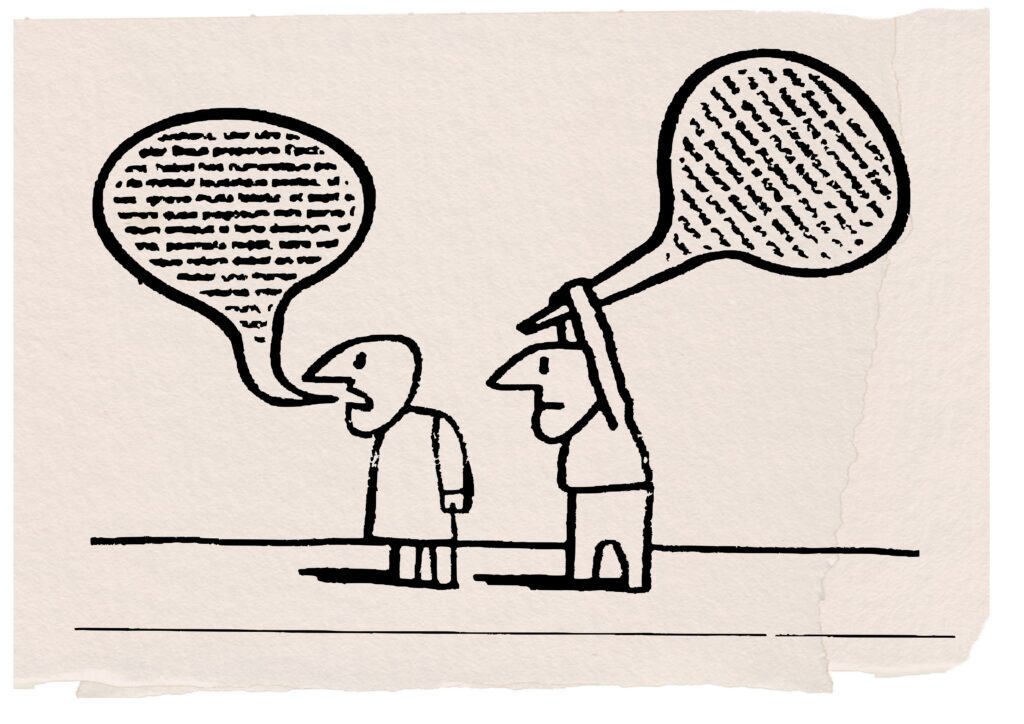
B. Le courant opposé est celui qui nie la vision globale des droits à pension et se cantonne dans l’enceinte de la défense du budget de l’UE.
Alarmisme budgétaire, brandissant entre autres le risque d’ouvrir la boîte de Pandore à ceux dont les droits à pension ont dépassé 70% de leur traitement de base. Une revendication hypothétique non défendable, puisqu’aucune erreur ne saurait être excusée quant à la connaissance de l’existence du plafond de 70%.
La devise DON’T PAY s’est érigée en principe pseudo-juridique et ceux qui revendiquent leurs droits ont été vus comme des profiteurs. Les victimes de l’incompétence, parfois même de la malveillance, des responsables, ne se remettront jamais du traumatisme de la spoliation subie en donnant une signature par laquelle le produit de leur travail est parti en fumée.
Si les intentions des cerbères du budget sont ostensibles, c’est la méthode de démolition de l’arrêt Barroso Truta qui est la plus pernicieuse. Il ne s’agit pas là d’un simple revirement de jurisprudence. Le changement du sens des mots sape l’arrêt lui-même et d’autres affaires de la jurisprudence, en court-circuitant, en plus, l’interprétation et l’application de dispositions du statut et des DGE, de façon à priver le cadre juridique de sa clarté pour devenir une Tour de Babel.
Le passage « la partie du capital de ses droits à pension nationaux transféré vers le régime de pensions de l’Union dont il ne sera pas tenu compte lors de la liquidation des droits à pension » a, paraît-il, pris le sens de ‘morceaux’ de droits à pension qui, lors du transfert, sont tombés à la trappe. Or, si jamais il y avait eu une erreur ou une omission, les pensions peuvent être révisées à tout moment d’office (art. 41, annexe VIII). Une fois qu’il n’y a pas eu d’erreur ou d’omission, l’école DON’T PAY considère que tout est en ordre et qu’il n’y a rien à rembourser. Si les calculs ont été faits conformément aux règles en vigueur, le montant transféré IN a, selon eux, bien été « pris en compte » au titre du 2e alinéa, même sans avoir eu aucun effet sur la pension, qui a été fixée sur la base du 4e alinéa.
–t–
La saga des transferts à fonds perdu n’est pas terminée. Des victimes de l’incurie de l’administration découvrent, parfois avec un grand retard, la spoliation qu’ils ont subie. Les institutions doivent payer !
Avec retard, la Commission a attiré, sur son site My IntraComm, l’attention sur l’existence de la règle du minimum vital. Si la règle du minimum vital est inspirée de nobles intentions, le mécanisme de sa mise en œuvre appelle une réflexion à la même hauteur.
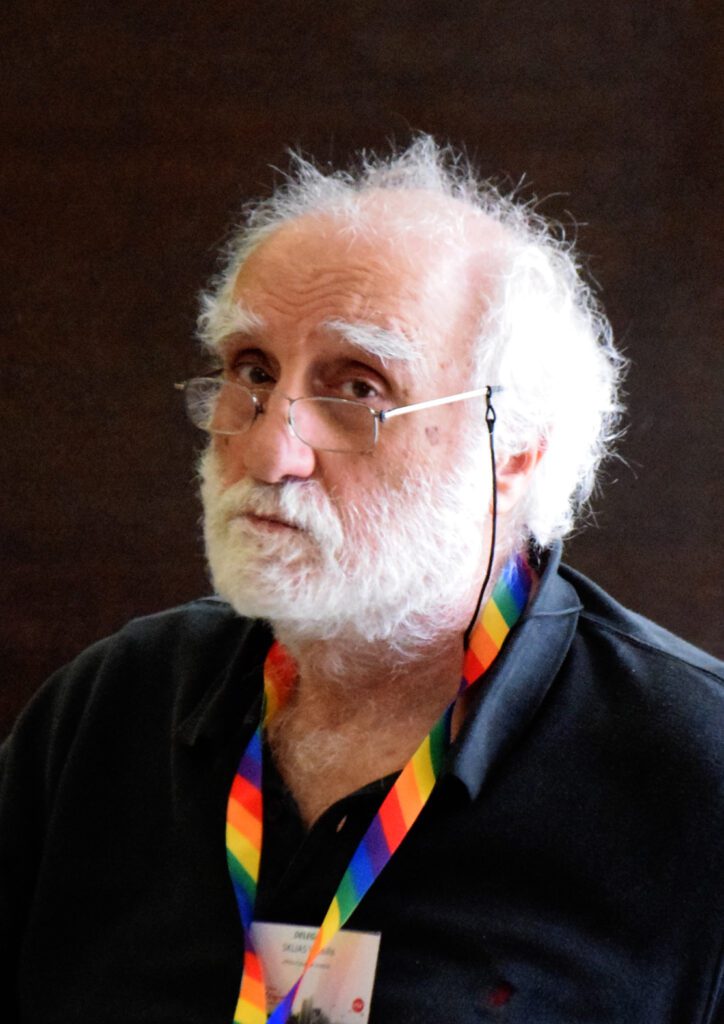
Vassilis SKLIAS
A PROPOS DE L’AUTEUR
Secrétaire-général EPSU- CJ et membre du comité fédéral USF

Michel WEISER
A PROPOS DE L’AUTEUR
Membre d’EPSU-CJ