Dans une société démocratique, la liberté d’expression n’est jamais un acquis définitif ; elle doit être sans cesse réapprise, protégée et exercée avec discernement.
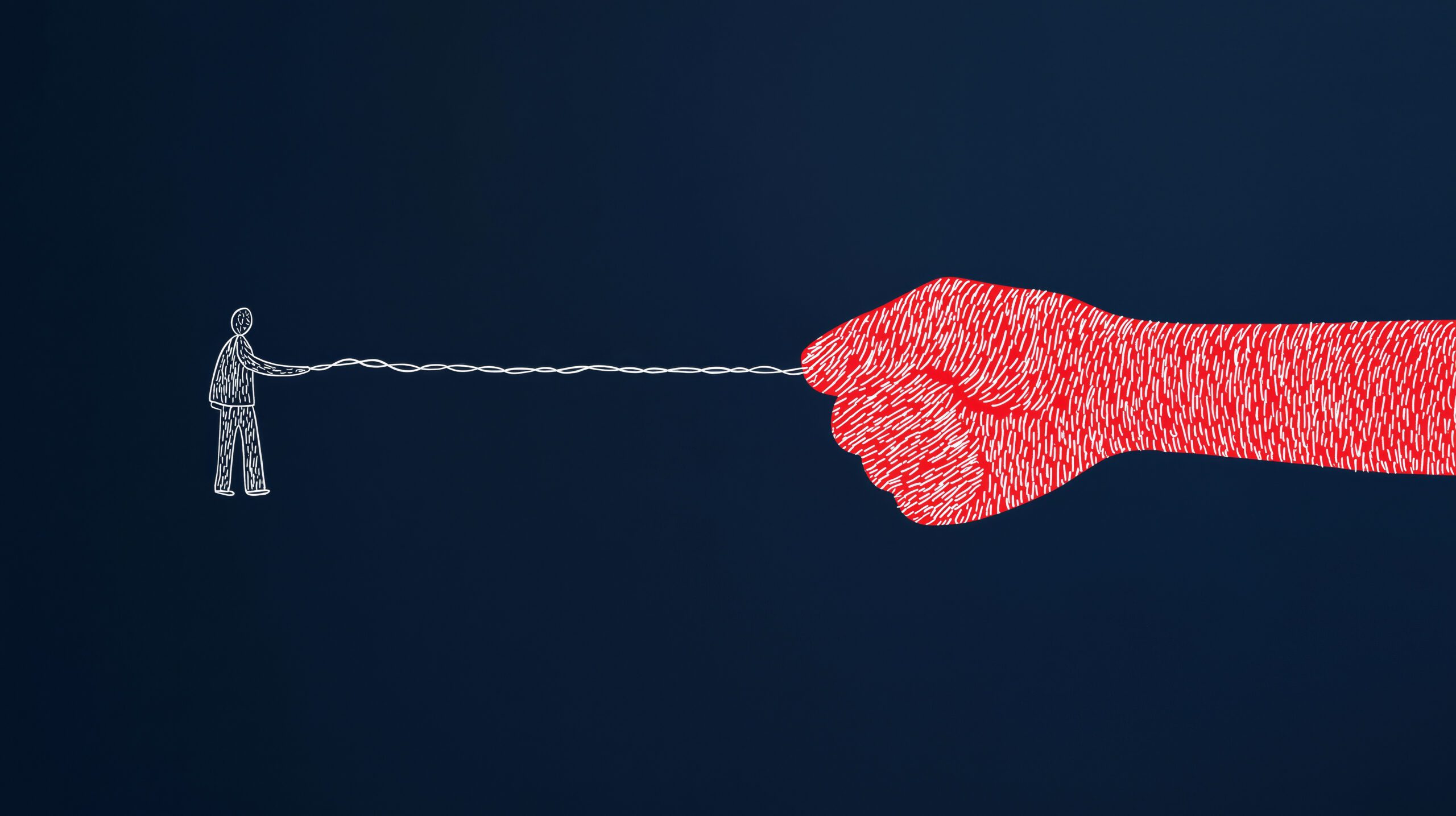
Liberté syndicale et liberté d’expression :
« Il n’y a pas de liberté sans responsabilité et sans contrôle. L’absence de responsabilité et de contrôle met autant la liberté en danger que les interdictions et les censures. Une liberté privée de règles n’existe que dans une démocratique anarchie, donc destinée à périr. Le premier effet de cette situation est de provoquer des réactions puritaines et autoritaires. »
L’écrivain Jean Daniel affirmait qu’il n’y a pas de liberté sans responsabilité et sans contrôle. Je ferai volontiers écho à cette pensée : il n’y a pas de liberté sans responsabilité, pas de dialogue sans respect, pas de progrès sans contradiction.
Ce mantra me revient souvent à l’esprit lorsque je défends un agent ou un représentant syndical confronté aux limites parfois fragiles entre le droit de s’exprimer et le devoir de loyauté. En fonction publique européenne, la liberté syndicale est une réalité juridique reconnue, mais elle demeure un terrain d’équilibre précaire : protégée, certes, mais encadrée ; valorisée, mais parfois redoutée ; essentielle au dialogue social, mais souvent source de tensions institutionnelles.
S’exprimer est autorisé, mais retenez-en déjà la règle de base : agir librement, mais avec discernement ; parler franchement, mais avec respect ; contester, mais pour avancer.

Un droit fondamental sous tension
La liberté syndicale, telle qu’elle est consacrée à l’article 24 bis du Statut des fonctionnaires de l’Union européenne, est un pilier du dialogue social européen. Ce texte impose aux institutions de « ne rien faire qui puisse entraver l’exercice de la liberté syndicale ». C’est un droit qui se situe au croisement du droit du travail et du droit constitutionnel, puisqu’il découle à la fois des principes généraux du droit de l’Union, de la Charte des droits fondamentaux[1] et de la Convention européenne des droits de l’homme[2].
L’organisation syndicale constitue, en ce sens, le vecteur légitime de l’expression collective du personnel. Elle est le cadre dans lequel la parole syndicale trouve non seulement sa force représentative mais aussi la protection juridique attachée à son mandat. Lorsqu’un représentant s’exprime au nom de l’organisation qu’il incarne, sur la base d’une position adoptée collectivement, il agit en sa qualité de porte-parole du syndicat, et non à titre individuel et personnel.
Dans ce contexte, il ne peut en principe lui être reproché de n’avoir pas sollicité d’autorisation préalable au sens de l’article 17 bis du Statut : la publication, la prise de position ou la communication dont il est l’auteur ne relèvent pas de sa sphère personnelle, mais de l’expression syndicale protégée. C’est précisément ce rôle de « véhicule d’expression » que le droit reconnaît à l’organisation syndicale : permettre la circulation de la critique, de l’information et du débat, tout en protégeant ceux qui en assurent la voix.
Pourtant, dans la pratique institutionnelle, ce droit est loin d’être univoque. L’équilibre qu’il implique avec d’autres obligations statutaires – en particulier le devoir de loyauté et le devoir de dignité et de réserve – en fait un terrain où se jouent les tensions les plus délicates de la fonction publique européenne : celles entre l’esprit critique et l’obéissance hiérarchique, entre le militantisme et la neutralité, entre la défense d’un collectif et la fidélité à une institution.
Si l’article 11 du Statut encadre la loyauté, et l’article 12 la dignité et la réserve, l’article 24 bis en est le contrepoint : il garantit la liberté de représentation, de parole et de contestation au sein du cadre institutionnel.
Ces tensions ne sont pas théoriques. Elles traversent la jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice de l’Union européenne depuis les années 1990. Dans certaines affaires, des institutions ont été rappelées à l’ordre pour avoir tenté d’entraver la circulation d’informations syndicales – par exemple en ordonnant à leurs services internes de messagerie de bloquer temporairement la diffusion de bulletins syndicaux[3]. Ces arrêts rappellent qu’aucune mesure administrative ne peut viser à limiter ou retarder la communication syndicale sans violer la liberté d’expression collective des agents.
Mais inversement, la même jurisprudence souligne que cette liberté n’est pas absolue. Lorsqu’une expression dépasse la critique institutionnelle pour devenir une attaque personnelle ou une atteinte à l’honneur, elle peut justifier une réaction de l’administration. Ce subtil jeu de miroirs entre droits et devoirs est au cœur de la réflexion juridique contemporaine sur la démocratie au travail[4].
—
[1] Article 12 de la Charte.
[2] Article 11 de la Convention.
[3] CJCE, arrêt du 18 janvier 1990, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, C-193/87 et C-194/87, point 13.
[4] Nous avions d’ailleurs contribué au #92 de l’Agora qui en faisait son sujet principal de contributions.
L’obligation de loyauté : une exigence à replacer dans son contexte
La loyauté impose au fonctionnaire d’agir « uniquement dans l’intérêt de l’Union ». Ce devoir est souvent invoqué par les administrations pour encadrer ou critiquer l’expression syndicale. Mais la Cour a rappelé à plusieurs reprises que cette obligation n’est pas absolue : elle doit être appréciée en tenant compte du contexte.
Ainsi, lorsque l’expression du fonctionnaire s’inscrit dans un cadre syndical ou militant, elle obéit à une logique différente de celle de l’expression hiérarchique. Le militant n’est pas un agent désobéissant ; il est un acteur du dialogue social, souvent investi d’un mandat représentatif et donc d’une légitimité particulière. C’est précisément ce qu’a reconnu la jurisprudence : l’obligation de réserve et de loyauté doit être interprétée de manière moins stricte lorsqu’il s’agit d’une expression syndicale ou d’une communication en vue d’une assemblée générale du personnel[1].
Autrement dit, la critique devient acceptable, même vive, tant qu’elle demeure proportionnée et constructive. La violation du devoir de réserve ne peut être retenue qu’en présence de propos d’une gravité particulière, tels que des expressions gravement injurieuses ou manifestement attentatoires à la dignité des personnes visées.
Cet assouplissement est fondamental, car il traduit la reconnaissance d’un fait institutionnel : le syndicalisme repose sur le débat, parfois sur la confrontation, et donc sur une parole libre. Restreindre cette parole au nom d’une loyauté mal comprise reviendrait à neutraliser toute forme de représentation collective[2].
Pourtant, l’histoire de la fonction publique européenne montre que cette évidence n’a pas toujours été admise. Dans certaines affaires, les juridictions de première instance avaient considéré que « les raisons expliquant le comportement du fonctionnaire n’avaient pas d’importance » pour juger s’il avait manqué à son devoir de loyauté. Cette approche formaliste a été corrigée : la loyauté ne se juge pas dans l’absolu, mais à la lumière du contexte.
Ce rappel du juge est capital. Il signifie que le militantisme, l’engagement syndical ou le fait d’exprimer un désaccord institutionnel ne constituent pas en soi un manquement disciplinaire. Ce qui importe, c’est la finalité de l’acte : a-t-il pour but de nuire à l’institution ou, au contraire, de contribuer à son amélioration ?
—
[1] TUE, arrêt du 15 décembre 2021, HG v European Commission, T 693/16, EU:T:2021 :895, points 83 et 95-98.
[2] Je fais ici un clin d’œil à un représentant du personnel qui m’a fait découvrir l’ouvrage de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations : Vers des communautés de travail inspirées (Diateino, 2014). Cet essai, devenu une référence mondiale en matière d’évolution des structures managériales, retrace les différents stades de développement des organisations, depuis les modèles hiérarchiques autoritaires jusqu’aux formes plus « opales » ou « évolutives » fondées sur la confiance, l’autonomie et le sens collectif.
La lecture de Laloux est précieuse lorsqu’on observe le fonctionnement institutionnel : elle offre une grille de compréhension des comportements organisationnels qui, transposée au secteur public européen, éclaire la nature des tensions que nous rencontrons. Il est fascinant — et souvent troublant — de constater, au fil des dossiers, à quel point le style de management ou d’administration en cause semble correspondre à l’un des paradigmes décrits par l’auteur : structure rigide, méfiance systémique, peur du désordre, contrôle excessif des communications, ou au contraire culture de dialogue et d’apprentissage collectif.
Dans bien des affaires disciplinaires ou d’enquêtes administratives, les limites identifiées par Laloux se vérifient : une gouvernance ancrée dans le contrôle plutôt que dans la confiance, un réflexe de protection hiérarchique plutôt que d’écoute, une gestion des conflits qui privilégie la sanction à la compréhension.
Mais l’excès inverse n’est pas exempt de dérives : une culture managériale centrée sur l’inclusion et la recherche permanente d’interaction peut, lorsqu’elle manque de cadre, être perçue comme une faiblesse ou une absence de responsabilisation, voire comme un défaut de conscientisation des enjeux et des limites de chacun.
Ces schémas, lorsqu’ils ne sont pas dépassés, conduisent inévitablement à la défiance, à la crispation institutionnelle et, souvent, à la judiciarisation des relations de travail.
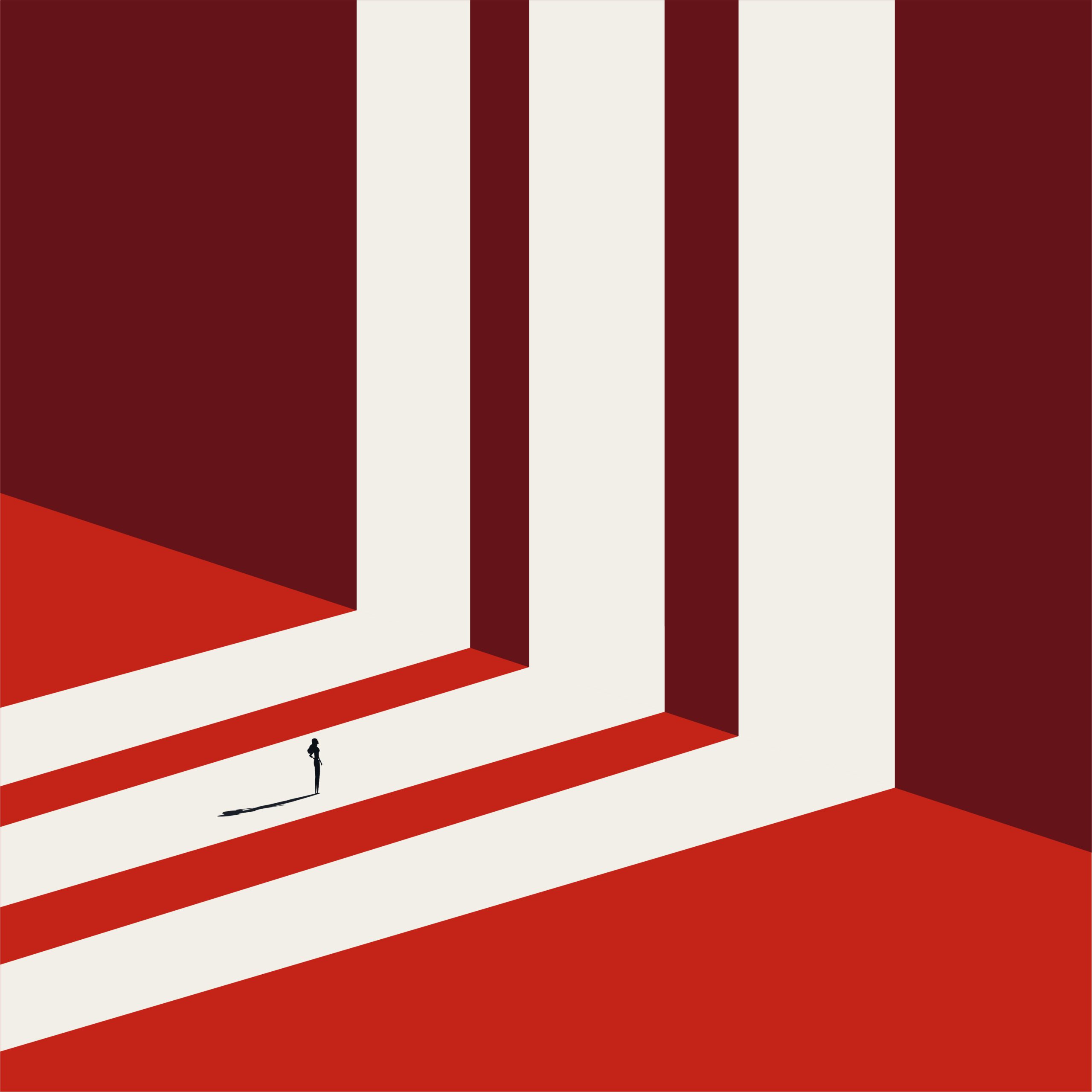

La liberté d’expression syndicale : un droit exigeant, encadré par la proportionnalité
La liberté d’expression n’est jamais purement déclarative. Elle vit par l’usage qu’on en fait, et elle se teste dans les moments de tension. Dans le contexte syndical, elle s’exerce souvent à travers des communiqués, des tracts, des messages électroniques ou des interventions lors de réunions du personnel.
Or, cette liberté connaît des limites : la critique ne doit pas se transformer en diffamation, et la dénonciation d’un dysfonctionnement ne doit pas dégénérer en attaque personnelle. C’est dans cette nuance que se joue la frontière entre la liberté et l’abus.
La jurisprudence impose ici un principe de proportionnalité : les propos ou actions du syndicat doivent rester nécessaires et adaptés à l’objectif poursuivi. Si le même message pouvait être transmis de manière moins agressive ou moins publique, sans perte d’efficacité, le juge pourra considérer que la communication a dépassé ce qui était « nécessaire ».
Cette exigence de modération n’est pas un appel à la tiédeur ; c’est une invitation à la responsabilité. Le syndicat ne perd pas sa voix, mais il doit en maîtriser la portée. La critique des procédures, des politiques de ressources humaines ou des conditions de travail reste légitime. Ce qui est proscrit, c’est la désignation nominative inutile, l’humiliation publique ou l’amalgame entre des manquements institutionnels et des comportements individuels.
Le juge, dans ces affaires, ne nie jamais la liberté syndicale ; il la replace simplement dans un cadre de respect mutuel. Il exige du syndicat qu’il reste fidèle à sa mission : défendre les intérêts du personnel et non régler des comptes personnels.
Quand la liberté d’expression rencontre le devoir d’assistance
À l’inverse, lorsque l’expression syndicale franchit la ligne et devient potentiellement attentatoire à l’honneur d’un agent, le droit impose à l’administration de réagir. L’article 24 du Statut prévoit en effet un devoir d’assistance : lorsque la dignité ou la réputation d’un agent est mise à mal, l’institution doit intervenir « avec toute l’énergie requise ».
Ce devoir n’est pas symbolique. Il oblige l’administration à agir rapidement et efficacement, à la fois pour faire cesser le comportement incriminé et pour indemniser, le cas échéant, la victime. Une simple invitation polie à publier un « corrigendum » n’est parfois pas suffisante : si l’administration reconnaît qu’un agent a été publiquement diffamé, elle sera souvent légitimement amenée à prendre des mesures concrètes à l’encontre de l’agent concerné et par la mise en œuvre d’une enquête administrative, offrira un soutien à l’agent atteint dans son intégrité, par la reconnaissance éventuelle du statut de victime d’un comportement déviant et la remise d’un rapport d’enquête l’établissant.
Ce mécanisme illustre parfaitement la logique de l’État de droit au sein même de la fonction publique : chaque liberté s’accompagne d’une responsabilité, et chaque droit trouve sa limite dans le respect des droits d’autrui.
Mais ici encore, la proportionnalité est de mise. Une mesure disciplinaire ou judiciaire demandée par une victime ne saurait être considérée comme une atteinte excessive à la liberté syndicale, dès lors qu’elle est nécessaire et adaptée à la gravité de l’abus.
L’administration se trouve donc dans une position d’équilibriste : elle doit protéger à la fois la liberté syndicale et la dignité individuelle. Et c’est souvent dans la manière de gérer ces situations – promptement, équitablement, sans partialité – que se révèle la maturité démocratique d’une institution.
Il faut toutefois regretter l’ouverture désormais exponentielle de dossiers d’assistance, qu’ils concernent des agents se disant victimes de dérives ou ceux qui se trouvent visés par des allégations. Ce phénomène traduit moins une explosion des comportements fautifs qu’un manque d’investissement structurel dans les ressources humaines et les outils de prévention.
Trop souvent, les institutions réagissent a posteriori, alors qu’il serait possible d’agir en amont, par la mise en place de mécanismes de régulation relationnelle ou la dispensation de formations à la communication, à la gestion du conflit et à la bienveillance au travail.
Ces démarches, orientées vers la compréhension psychologique et la qualité du dialogue, permettraient de réduire la judiciarisation des tensions et de rétablir des relations professionnelles éthiquement correctes, dans l’esprit même du service public européen.


L’enquête administrative : entre soupçon et présomption
Une autre source de tension, fréquente dans la vie syndicale, réside dans la conduite des enquêtes administratives. Lorsqu’un agent – et plus encore un représentant syndical – en fait l’objet, il ressent souvent une forme de stigmatisation, comme si la simple ouverture de l’enquête emportait déjà un jugement implicite. Juridiquement pourtant, la décision d’ouvrir une enquête ne constitue pas un acte faisant grief : elle n’est pas attaquable, car elle ne produit pas encore d’effet juridique définitif.
Le droit de l’Union considère ces enquêtes comme de simples mesures préparatoires, destinées à vérifier s’il existe un manquement aux obligations statutaires. L’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, pour autant qu’existe un soupçon raisonnable d’infraction. Cette approche peut sembler frustrante pour ceux qui la subissent, mais elle s’explique : toute procédure disciplinaire exige une phase préalable de vérification. Cela ne signifie toutefois pas que l’enquête échappe à tout contrôle : son déroulement et ses conclusions peuvent être examinés de manière incidente dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision disciplinaire finale.
La difficulté, ici encore, réside dans la perception. Une enquête ouverte dans un climat de tension syndicale peut aisément être interprétée comme un acte de représailles. C’est pourquoi les institutions doivent faire preuve d’une vigilance accrue : transparence, impartialité et prudence doivent guider leur action, afin que l’enquête demeure un instrument de vérité et non un outil de dissuasion de la contestation.
Dans bien des cas, l’enquête vise à évaluer le fondement factuel de l’expression syndicale : le travail de collecte, de vérification ou de recoupement effectué par le syndicat pour appuyer une publication ou une prise de position publique. Il s’agit de déterminer si cette expression repose sur des éléments tangibles et vérifiés, ou si elle se limite à relayer, sans distance ni analyse, la plainte isolée d’un membre du personnel.
Il arrive cependant que l’enquête prenne une tournure plus problématique encore : nous avons pu observer des situations où une seule personne – souvent celle qui a signé ou diffusé un message syndical collectif – se trouve visée isolément, alors même que la publication émane d’un groupe ou d’un organe représentatif. Une telle approche individualisée, outre qu’elle dénature la communication syndicale-même, porte atteinte à l’équité procédurale. Une réaction véritablement impartiale et équilibrée devrait logiquement impliquer l’ensemble des membres du collectif au nom duquel la publication a été réalisée.
À défaut, l’enquête risque d’être perçue, et à juste titre, comme stigmatisante pour le seul agent concerné, créant un sentiment d’injustice et renforçant la défiance envers les mécanismes internes de contrôle. Plus encore, le fait de n’être visé qu’individuellement pour avoir participé à la concrétisation d’une activité syndicale alimente la crainte de représailles personnelles. Ce risque de voir le militant syndical isolé dans la responsabilité d’un acte collectif peut conduire à une forme d’autocensure ou de renoncement à l’exercice même du mandat syndical. À terme, il fragilise la représentation du personnel et prive les agents de la défense collective que ces représentants ont précisément pour mission d’assurer.
Lorsqu’une organisation syndicale s’est montrée prudente et rigoureuse, qu’elle a vérifié les faits, signalé les incertitudes et communiqué avec transparence les précautions d’usage quant à ce qui n’était pas établi, il sera difficile de considérer qu’elle a outrepassé ses droits. Ses représentants, agissant dans l’exercice de leur mandat d’information, auront ainsi concrétisé leur liberté d’expression sans violer leur devoir de loyauté.
Liberté syndicale et démocratie au travail : un miroir de la gouvernance institutionnelle
Au-delà des textes et des jurisprudences, la question de la liberté syndicale renvoie à une vision plus large de la démocratie au travail. Elle interroge la manière dont les institutions européennes incarnent les valeurs qu’elles promeuvent.
Dans ma pratique, j’ai souvent été frappée par le contraste entre les principes affichés et les comportements observés. D’un côté, un discours institutionnel valorisant le dialogue social, la diversité et l’écoute ; de l’autre, des pratiques internes où la critique est vite perçue comme une menace, où le débat est confiné dans des procédures de consultation purement formelles.
Or, la démocratie ne se décrète pas ; elle se vit. Elle suppose un espace où la parole syndicale n’est pas seulement tolérée, mais reconnue comme une composante légitime de la vie institutionnelle. Ce n’est pas un hasard si le Statut a voulu que les représentants du personnel bénéficient d’une protection particulière : ils ne défendent pas leurs intérêts personnels, mais ceux d’une collectivité. Et nous veillerons d’ailleurs toujours, en toute franchise, à le leur rappeler si tant est que de besoin.
J’aime comparer la liberté syndicale à un thermomètre : elle mesure la capacité d’une institution à accueillir la contradiction sans la percevoir comme une atteinte à son autorité. C’est dans la manière dont elle traite ses représentants, dans la qualité du dialogue instauré avec eux, que se lit la vitalité démocratique de son fonctionnement.
Les affaires disciplinaires impliquant des syndicalistes, souvent médiatisées ou politisées, en sont un révélateur. Elles montrent combien la frontière est ténue entre l’exercice légitime d’une liberté et son instrumentalisation répressive. Là encore, c’est au juge qu’il revient de tracer la ligne, d’examiner la proportionnalité des mesures, d’évaluer la bonne foi des acteurs. Mais la justice, aussi essentielle soit-elle, ne devrait être qu’un ultime recours.

Pour une culture de la parole responsable
Dans une société démocratique, la liberté d’expression n’est jamais un acquis définitif ; elle doit être sans cesse réapprise, protégée et exercée avec discernement. Dans la fonction publique européenne, cette exigence est d’autant plus forte que les agents incarnent l’Union, ses valeurs mais aussi et surtout ses contradictions.
Le syndicalisme, dans ce cadre, n’est pas un contre-pouvoir hostile ; il est une composante du pouvoir de réflexion. Il participe à l’éthique institutionnelle en questionnant les pratiques, en rappelant la cohérence entre les principes affichés et les comportements concrets.
Mais cette mission implique aussi une responsabilité : celle de s’exprimer avec rigueur, de distinguer la critique du discrédit, et d’utiliser la parole comme un outil de construction. Le juge européen, à travers sa jurisprudence, ne dit pas autre chose : il ne bride pas la liberté syndicale, il en rappelle simplement la noblesse.
Au terme de cette réflexion, il apparaît que la liberté syndicale et la liberté d’expression ne sont ni des privilèges ni des prétextes : ce sont des instruments d’équilibre. Leur exercice exige de la part des agents et des institutions une conscience aiguë de leurs devoirs réciproques.
Les textes européens – du Statut au Traité en passant par la Charte des droits fondamentaux – ne cessent de rappeler que la démocratie interne des institutions doit être à l’image de celle qu’elles promeuvent à l’extérieur. Cela suppose une ouverture au dialogue, une transparence des procédures et une réelle capacité d’autocritique.
Le rôle du syndicat, dans ce schéma, est essentiel : il rappelle à l’administration qu’elle n’est pas une forteresse mais une organisation humaine, soumise au droit, et qu’elle ne peut exiger la loyauté sans offrir en retour la confiance.
La loyauté, finalement, n’est pas l’obéissance. Elle est un engagement partagé envers une mission commune : celle de servir l’intérêt général européen. Et cet intérêt ne saurait s’accommoder du silence.
Nous conclurons en ces termes : dans le dialogue parfois heurté entre agents et hiérarchie, il y a toujours une promesse : celle que la parole, lorsqu’elle est sincère et responsable, reste le meilleur rempart contre l’arbitraire. Et c’est peut-être là, au cœur de cette dialectique exigeante, que réside la véritable démocratie au travail.

Maître Nathalie de Montigny
A PROPOS DE L’AUTEUR
Nathalie de Montigny, spécialiste en droit de la fonction publique européenne. Elle conseille et assiste également ses clients en droit économique. En 2018, elle fonde son cabinet d’avocats LEXENTIA. Elle enseigne le droit européen à ses jeunes confrères au Barreau de Bruxelles et organise également différents cycles de conférence en droit national ou européen, au bénéfice du personnel des Institutions européennes.