Je vous invite à diriger votre colère, camarade, pour nous faire grandir. Apportez vos idées. Donnez-nous votre énergie.

L’article ci-dessous, bien qu’il traite du cas spécifique d’un journaliste, dépasse largement le cadre local du syndicat des journalistes au Portugal. Ce conflit d’arguments soulève de nombreuses questions que les syndicalistes doivent se poser.
Fumaça (fumaca.pt) est un podcast portugais indépendant et à but non lucratif consacré au journalisme d’investigation, lancé en 2016. Il se concentre sur l’examen minutieux des systèmes d’oppression. Ses membres se considèrent comme indépendants, dissidents et anti-autoritaires, car ce sont les journalistes qui, sans administration, sans direction et sans hiérarchie, décident de manière horizontale du destin de la publication, en utilisant le consensus comme processus décisionnel. Ils défendent des alternatives aux structures journalistiques traditionnelles en matière de financement, de pratiques éditoriales et de travail, et de modèles organisationnels. Ils aspirent à une transparence éditoriale et opérationnelle radicale et ne croient pas en l’existence d’un journalisme neutre. Au contraire, ils reconnaissent clairement leurs subjectivités et leurs conflits d’intérêts.
Le 16 juin 2025, Ricardo Esteves Ribeiro, l’un des membres fondateurs, a rédigé la lettre d’information hebdomadaire intitulée « Le syndicat des journalistes, la béquille du capital » (« Sindicato de Jornalistas, muleta do capital », dans sa version originale en portugais). Il y décrit le long processus de désillusion qui l’a conduit à quitter le Syndicat des journalistes portugais (qu’il appelle le « Sindicato de Jornalistas »). Il raconte comment il a adhéré, plein de volonté de se battre pour de meilleures conditions matérielles pour lui-même et les autres, et comment, au fil du temps, il a été déçu par le syndicat et, après sept ans, a démissionné.
Il présente une longue liste, mais insiste particulièrement sur le fait que le syndicat n’a pas soutenu son action en tant que journaliste et ne lui a pas fourni par la suite l’assistance juridique appropriée, que ce soit pour traiter les multiples cas de brutalité policière à l’encontre de journalistes ou les poursuites judiciaires intentées par les personnes visées par ses reportages. Après réflexion, Ricardo explique également qu’il ne pense pas que les syndicats soient les structures appropriées pour remettre en cause la dichotomie patron-travailleur. Selon lui, le problème réside dans le syndicalisme lui-même, car pour que les syndicats puissent remplir leur rôle de représentation des travailleurs, les employeurs doivent les reconnaître comme des représentants légitimes, ce qui signifie que les syndicats doivent à leur tour reconnaître l’autorité des employeurs et se comporter dans les limites d’une négociation appropriée.
C’est dans le cadre de la réponse aux griefs de Ricardo que Nuno Viegas répond une semaine plus tard. Sa réponse est l’article que vous pourrez lire ici.
Le syndicat est ce que vous en faites
Je ne cesse d’être étonné de voir comment les capitalistes parviennent à tirer profit même des principes des anticapitalistes. Au bénéfice des employeurs, les travailleurs quittent les syndicats pour une multitude de raisons. Dans le prolongement de la lettre d’information de mon camarade Ricardo Esteves Ribeiro de la semaine dernière, j’aimerais examiner l’une de ces voies menant à la destruction des mouvements ouvriers : l’altérisation du syndicat, sa transformation en un organisme extérieur à la classe ouvrière qu’il représente, mais avec lequel il entretient une relation purement bureaucratique.
En effet, les syndicats se transforment en prestataires de services grâce à une approche de l’action collective fondée sur le marché, dans laquelle les travailleurs qui ne participent pas à la direction du syndicat interagissent avec l’organisation dans le cadre d’un modèle transactionnel afin d’exiger des réponses à leurs besoins individuels : demander une assistance juridique, communiquer sur leurs griefs ou organiser des colloques sur leurs intérêts.
Certains syndicats se sont eux-mêmes mis dans cette situation. Ils s’accrochent à des hiérarchies rigides et restent sous la direction des mêmes personnes pendant des années. Ils s’empêtrent dans des luttes pyrrhiques qui ne leur rapportent que de maigres victoires. Ils encouragent l’adhésion en offrant des réductions, en annonçant que les cotisations sont déductibles des impôts ou en se proclamant assureurs : « payez chaque mois pour pouvoir un jour faire appel à nos avocats ». Ainsi, voyant leurs conditions de travail se détériorer chaque année, les travailleurs perdent espoir dans la capacité du syndicat à obtenir ne serait-ce que des améliorations mineures, sans parler de remodeler fondamentalement le modèle social qui les condamne à une vie passée à obéir à leurs patrons et à mendier auprès des administrateurs pour obtenir de maigres augmentations de salaire. De la même manière que nous cesserions d’aller dans une épicerie vendant des fruits pourris, si le syndicat ne résout pas nos difficultés personnelles, nous abandonnons le projet collectif.

Mais critiquer les syndicats uniquement pour ces déceptions personnelles, même lorsqu’il s’agit d’échecs graves, pose un problème de perspective. Dans son premier paragraphe, Ricardo Esteves Ribeiro déclare que lorsqu’il a rejoint le syndicat des journalistes (SinJor) en 2018, il avait « la volonté de lutter pour de meilleures conditions matérielles » pour la classe, comprenant que « le minimum serait de renforcer le syndicat ». Mais l’exemple qu’il donne pour illustrer sa volonté « d’aider ceux qui dépensent déjà leur énergie à lutter pour obtenir des droits supplémentaires et meilleurs pour ceux qui travaillent à leurs côtés » consiste à offrir « une autre adhésion syndicale et les quelques euros mensuels que cela implique ».
Je dirais que, sur ce sujet, les syndicats sont comme des clubs de sport. La cotisation seule ne suffit pas pour obtenir des résultats. Le changement demande des efforts. La cotisation de 1 % de notre salaire est un don, pas un acte militant. Elle fait évidemment une différence. Les cotisations versées l’année dernière par 1 700 journalistes ont permis à SinJor de fournir des services juridiques gratuits à 200 membres, afin de les protéger contre les licenciements abusifs, d’obtenir des contrats après des années de faux travail indépendant et de lutter contre les poursuites judiciaires illégitimes qui tentent de conditionner leur travail journalistique. Mais ce n’est pas cela, un syndicat.
Je partage les préoccupations de mon camarade. Les avocats échouent-ils ? Sans aucun doute. Le syndicat prend-il position lorsque cela est nécessaire ? Pas toujours. Invite-t-il les mauvaises personnes à prendre la parole sur son podium ? Parfois. Et pourquoi un syndicat qui, pendant un an, ignore l’un de ses membres, s’attendrait-il à ce que celui-ci reste membre ?
Il est tout à fait compréhensible que les journalistes soient déçus par un syndicat qui n’a réussi qu’à ralentir le déclin. Dans chaque salle de rédaction, il y a des raisons légitimes d’être mécontent ou déçu, que ce soit pour les six derniers mois ou les vingt dernières années. La convention collective du personnel de la radio, qui est en cours de renégociation, n’a pas garanti d’augmentation salariale depuis 2006. Il n’y a pas de négociation collective pour les chaînes de télévision privées. Les sections photographie sont en train de disparaître. Le stage obligatoire pour obtenir l’accréditation professionnelle sert de mécanisme coercitif pour accéder à une main-d’œuvre bon marché.
L’action syndicale, dans un contexte de crise profonde de la viabilité des médias, s’est avérée insuffisante. Cette affirmation ne nécessite aucune autre preuve que les salaires que nous percevons et le travail que nous nous imposons à la publication.
Ce n’est pas la critique qui nous sépare. C’est moi qui pense que ce que vous avez lu jeudi dernier est un bon point de départ pour une discussion avec les autres membres lors d’une assemblée générale, où les défauts sont mis à nu, des solutions sont proposées et un consensus est recherché pour améliorer l’organisation dont nous faisons partie. Et je crains que l’apathie frustrée continue de prévaloir parmi les journalistes. Par indifférence agacée, nous laissons les déceptions s’accumuler, en supposant que les structures qui nous font défaut sont immuables. Nous renonçons donc à les influencer et commençons à considérer la participation comme du collaborationnisme.
Il existera des structures irréformables, qui maintiennent une telle distance par rapport à leur militantisme et un tel degré de bureaucratisation que toute intervention démocratique est pratiquement impossible. Des syndicats où être membre ne signifie rien de plus qu’être une statistique. Cependant, sans montrer que nous avons touché le fond de ce puits hiérarchique, l’appel à baisser les bras, même pour des raisons morales évidentes, n’est rien d’autre qu’une faveur, une béquille… offerte au capital.


Une critique qui n’est jamais formulée n’a aucun impact
Non seulement je ne pense pas que SinJor soit irrémédiablement figé, mais il me semble évident que les critiques que vous lisez ici doivent nous rappeler que les syndicats existent pour être pris en main par les travailleurs. Ce sont des arènes politiques. C’est à chacun d’entre nous de créer des mécanismes de mobilisation collective qui nous servent. Si nous pensons qu’un syndicat digne de ce nom doit naître de l’organisation autonome de chaque newsroom, assemblée après assemblée, il est de notre devoir de le construire. Si nous attendons plus d’ambition et des moyens de lutte plus radicaux de la part des syndicats existants, nous avons l’obligation de les influencer. Si un syndicat ne sert pas sa militance, il doit être refondé. SinJor, je m’en suis rendu compte, est perméable à sa militance, avec quelques efforts.
En 2021, j’ai également été menacé de poursuites judiciaires par Strong Charon et j’ai envisagé de partir en raison de l’inaction du syndicat. J’avais ma propre liste de déceptions : propositions insuffisantes pour financer le journalisme, manque d’ambition pour lutter contre l’organisation oppressive des salles de rédaction, surveillance fragile des violations répétées du code de déontologie et manque de solidarité avec les autres mouvements de travailleurs. Et j’ai trouvé étrange que le syndicat – dans ce que j’aurais considéré comme une pratique souhaitable – ne m’ait jamais contacté pour s’informer de mes conditions de travail et m’expliquer comment je pouvais m’impliquer, même lorsque je travaillais dans un grand groupe de presse en 2019 [muté].
J’ai peu demandé au syndicat, j’ai donné encore moins et je n’ai rien reçu. Cela n’a toutefois pas changé mon opinion depuis 2021, lorsque, pour citer mon camarade, nous avons conclu : « La meilleure façon de lutter contre ce conformisme inacceptable et ce manque de solidarité répréhensible est de rester syndiqué, de voter aux élections internes et d’utiliser mon adhésion pour critiquer les actions de l’organisation. Je ne partirai pas, afin de pouvoir formuler ces critiques de la manière la plus efficace possible. »
Examinons une critique figurant dans la première ligne de la newsletter de la semaine dernière. Ricardo y fait référence à SinJor, « Sindicato dos Jornalistas », en utilisant « Sindicato de Jornalistas » (évitant ainsi la forme genrée, car en portugais, « dos » est un déterminant masculin et « de » est utilisé comme déterminant neutre). Ceux qui ne sont pas d’accord avec le nom d’une organisation dont ils font partie peuvent adopter l’une des deux approches suivantes. Pour commencer, ils peuvent s’efforcer de parvenir à un consensus.
Tout d’abord, vous devriez vérifier si cette question a déjà été abordée, soit en envoyant un courriel ou en appelant un membre du comité directeur, soit en vous rendant au siège social, qui, pendant des années, se trouvait à moins d’un kilomètre de la salle de rédaction de Fumaça. Ensuite, discutez avec d’autres collaborateurs pour savoir si d’autres personnes sont d’accord. Si ce n’est pas le cas, réfléchissez à la manière d’entamer la discussion et de constituer une masse critique favorable. Cela pourrait déboucher sur un vote lors du prochain congrès de classe, peut-être associé à une intervention sur le genre dans les salles de rédaction. À un moment donné, nous devrons essayer de le faire voter lors de l’assemblée générale du syndicat. Si cela échoue, insistez.
Une autre option : comme l’a fait Ricardo Esteves Ribeiro, un changement de nom unilatéral à la Trump. Gênés par le nom du syndicat, nous l’écrivons différemment pendant une journée, en conservant la réalité inchangée et le nom genré. Peut-être n’essayons-nous pas d’intervenir parce que nous pensons que nous échouerons. Mais je préfère échouer à changer les choses plutôt que de réussir à les embellir.

Pour ma part, j’ai échoué dans ma tentative de changer le nom de notre dernier congrès. En juillet 2022, je me suis rendu à une assemblée générale extraordinaire à 21h30 un vendredi soir pour discuter des préparatifs du 5e « Congresso dos Jornalistas Portugueses ». J’ai suggéré de mettre l’accent sur la viabilité financière et l’organisation des salles de rédaction, de permettre aux étudiants d’intervenir dans les débats et de changer le nom pour qu’il s’agisse du 5e « Congresso de Jornalistas de Portugal ». Je n’ai pas demandé de vote. Même si je pensais avoir convaincu une grande partie de l’assemblée, lorsque l’événement a débuté en janvier 2024, le nom est resté le même.
Lors du congrès actuel, mes interventions ont porté principalement sur la transparence et l’éthique, plutôt que sur la nomenclature. Sous la pression d’un autre Ricardo (Cabral Fernandes, alors à la publication Setenta e Quatro), j’ai également proposé une motion appelant à la première grève générale des journalistes depuis 1982. Nous avons rassemblé des dizaines de signataires et reformulé le texte afin de le fusionner avec deux propositions similaires, l’une émanant du SinJor lui-même, l’autre d’Ana Luísa Rodrigues, qui travaillait à la RTP. Comme l’avait suggéré l’ancienne présidente du syndicat, Sofia Branco, ce texte commun prévoyait que je rejoigne un comité de grève avec les signataires des motions, la direction du syndicat et le président de ce congrès, Pedro Coelho, journaliste à la SIC.
C’est à nous qu’il incombait de rédiger les revendications et de coordonner la préparation de la grève et les actions de mobilisation. Je ne détaillerai pas la très courte période qui a précédé la grève du 14 mars 2024, pendant laquelle, aux côtés de personnes beaucoup plus généreuses et compétentes que moi, j’ai passé des semaines à participer à des assemblées dans des salles de rédaction où je n’étais jamais entré, à produire de la propagande, des lettres ouvertes et des tribunes libres, à réfléchir à des stratégies de communication, à distribuer des tracts dans le métro jusqu’à ce que je sois expulsé par les employés de Carris, et à organiser des manifestations.
Je fais toute cette digression pour révéler qu’à la suite de la grève susmentionnée, l’actuel président de notre syndicat, Luís Filipe Simões, m’a invité à me joindre à une liste pour les prochaines élections. Et, précisément en raison des désagréments mentionnés ci-dessus, j’ai estimé qu’il serait déloyal de refuser. C’est pourquoi, depuis mai dernier, je fais partie des 13 membres de la direction nationale du syndicat, un poste que j’aimerais démanteler. Mais bien que ce soit ainsi que nous fonctionnons, j’ai consacré une partie de mon temps ces derniers mois à promouvoir une révision des statuts qui, outre d’autres modifications importantes, inclura une proposition à l’assemblée générale visant à changer le nom de cette organisation presque centenaire pour, précisément, Sindicato de Jornalistas. C’est un changement qui sera approuvé, si ce n’est maintenant, plus tard. Comme d’autres changements beaucoup plus importants.
Être distant n’est pas la même chose qu’être hermétique
Je soutiens la critique de la léthargie institutionnelle. Mais dire que la montagne ne bouge pas sans jamais essayer de la pousser est un argument faible. Et mon camarade, qui a des impulsions stimulantes à donner, n’a voté qu’une seule fois en huit ans lors de nos élections internes, ne s’est jamais présenté avec une liste alternative, n’a jamais participé à une assemblée générale, a manqué le dernier congrès, n’a jamais parlé aux comités directeurs syndicaux successifs de leur réforme ou de leur erreur d’inviter des politiciens et des directeurs de médias à prendre la parole, n’a jamais donné de son temps pour renforcer la pratique syndicale existante, ni pour la remettre en question de manière constructive au-delà des discours et des tribunes libres. Tout cela malgré le fait qu’il travaille dans une salle de rédaction privilégiée, où il a la liberté de le faire. Nous contrôlons nos heures de travail. Nous n’avons pas peur des représailles de nos patrons. À quel point est-il plus difficile dans d’autres salles de rédaction de trouver l’élan nécessaire pour intervenir dans le syndicat ?
Ne rien donner et ne rien demander au SinJor est plus courant que je ne le souhaiterais. Nous sommes une organisation qui manque de financement et dont le militantisme est limité. Pour des centaines de salles de rédaction, avec plus de 5 000 journalistes, nous avons 31 délégués syndicaux en fonction. Outre ces délégués et les 76 personnes qui composent les instances dirigeantes, seule une poignée de journalistes soutiennent quotidiennement le syndicat. C’est bien moins que ce qu’il faudrait pour former un syndicat vivant dans chaque rédaction. Nous manquons de journalistes qui contribuent à améliorer la pratique syndicale. Nous souffrons d’un désintérêt construit, d’une déception légitime et de la peur (nous avons des rédactions où nous ne pouvons pas convoquer d’assemblées plénières).
Une grande partie de la responsabilité repose sur nous, ceux qui avons donné de notre temps sans parvenir à maintenir un lien quotidien suffisant avec les salles de rédaction, à motiver la mobilisation constante des travailleurs, à intégrer correctement ceux qui nous rejoignent, à impliquer ceux qui restent dans la prise de décision et à communiquer régulièrement sur le travail accompli. Mais il y a aussi un désengagement général de la classe, qui reconnaissait autrefois exercer une profession éminemment politique, se consacrant à une mission civique, mais dont les membres ont été transformés en ouvriers d’usine de production d’informations, rouages d’un système de publication d’informations dépolitisé et dénué d’esprit critique.
Il suffit de voir le nombre restreint de publications qui ont élu des conseils de rédaction. Il suffit de voir le nombre restreint de publications qui critiquent mutuellement leur couverture médiatique. Il suffit de voir le nombre restreint de journalistes qui expriment publiquement leur désaccord les uns avec les autres.

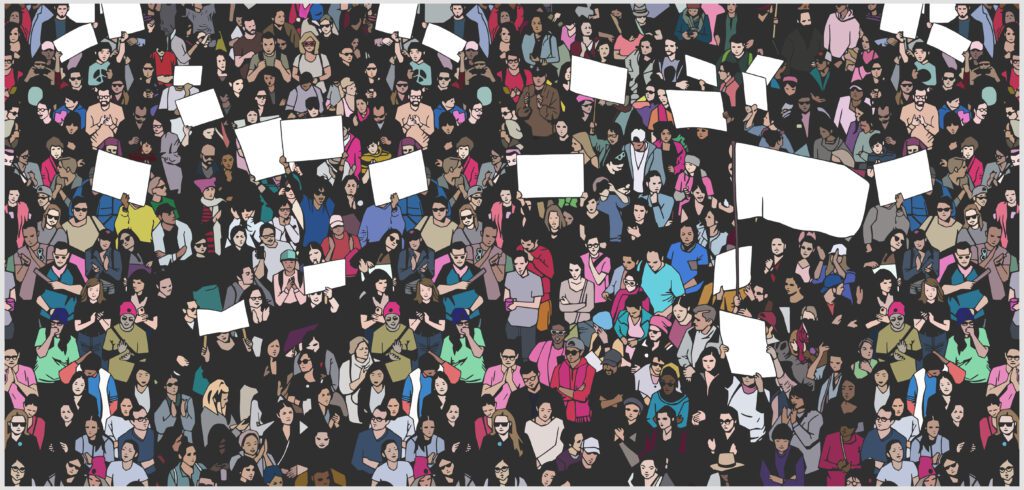
Pour résoudre le premier problème, nous pourrions exiger plus de préparation, de rigueur, de discipline et de dévouement de notre part, à nous qui occupons les instances officielles du syndicat. Mais pour le second, il n’y a pas de solution miracle. C’est en raison des limites imposées à la classe elle-même qu’il me semble irréaliste de proposer une révolution autogérée par elle-même.
La semaine dernière, Ricardo Esteves Ribeiro a écrit que SinJor ne sert que d’« intermédiaire entre les patrons et les travailleurs-journalistes », notamment parce que, « outre quelques propositions timides et éparses de modifications législatives visant à faciliter la création de coopératives journalistiques », il ne remet pas en cause « la relation employeur-employé elle-même ». Compte tenu du départ de Ricardo du syndicat, on peut en déduire qu’il considère la participation à cette structure comme une légitimation d’un statu quo qu’il méprise.
Il écrit donc : « Je ne vois pas que le Sindicato de Jornalistas souhaite autre chose qu’améliorer légèrement les anciennes pratiques de travail ». Eh bien, c’est exactement ce que Fumaça tente de réfuter depuis le début. Ce que nous voulons, c’est participer à une révolution du journalisme. Pas de hiérarchies, pas de directeurs, pas de patrons, pas d’administrateurs. Et ces deux points de vue sont incompatibles. » Faisant partie des deux camps sans me sentir particulièrement divisé, je ne peux qu’être en désaccord.
Tout d’abord, parce que je ne peux ignorer la nécessité d’atténuer les dommages. Les acquis syndicaux ne sont pas insignifiants simplement parce qu’ils sont insuffisants. La lutte collective qui a empêché le licenciement de 200 personnes chez Global Media Group était bien réelle. Le soutien apporté actuellement aux photojournalistes que Medialivre tente de licencier est également réel. La lutte (continue) pour intégrer les travailleurs précaires au sein de RTP et, soit dit en passant, l’accord d’entreprise qui était en cours de négociation jusqu’à récemment, sont également réels.
Tout processus de reclassification permettant à une personne de récupérer des années de salaire qui lui ont été volées est réel. L’augmentation des salaires garantie par la convention collective de travail de la presse est réelle (même si elle est dérisoire). Et il existe un réel besoin d’exercer, de manière organisée, une influence sur la révision législative promise par [les partis gouvernementaux] PSD et CDS, en participant au choix des représentants de la Commission d’accréditation des journalistes professionnels et en intervenant au sein du conseil consultatif de l’Autorité de régulation des médias.
Ces résultats ne peuvent être considérés comme des horizons. En effet, ils sont loin d’être à la hauteur de toute ambition digne de ce nom, qu’il s’agisse d’une amélioration réformiste ou d’une refondation du secteur, mais je ne suis pas d’accord pour dire que la modération est une telle tare qu’elle justifie le désengagement et, je le crains, l’inaction.
Je citerai simplement un texte de Ricardo Esteves Ribeiro datant de 2023 : « La division du monde en un ensemble de dualités simplistes peut certes faciliter sa compréhension fondamentale. Il devient plus facile de choisir son camp si les alternatives sont limitées, s’il existe des lignes séparant le bien du mal. Mais le manichéisme n’a jamais été profitable. Certainement pas pour les manichéens originaux, qui ont toujours été persécutés, mais pas non plus pour une lecture honnête des dilemmes de notre vie collective. Le monde n’est pas noir et blanc, il n’est pas non plus uniquement composé de bien et de mal. Il existe des nuances, une compréhension complexe de problèmes complexes. Il y a l’histoire, le contexte. Mais comprendre les nuances, la complexité, l’histoire et le contexte est un travail difficile. Et les manichéens contemporains – ceux qui sont issus de cette religion que je connais peu – ne veulent pas se donner cette peine. Je n’ai même pas d’attachement particulier aux institutions, mais je leur accorde des nuances.

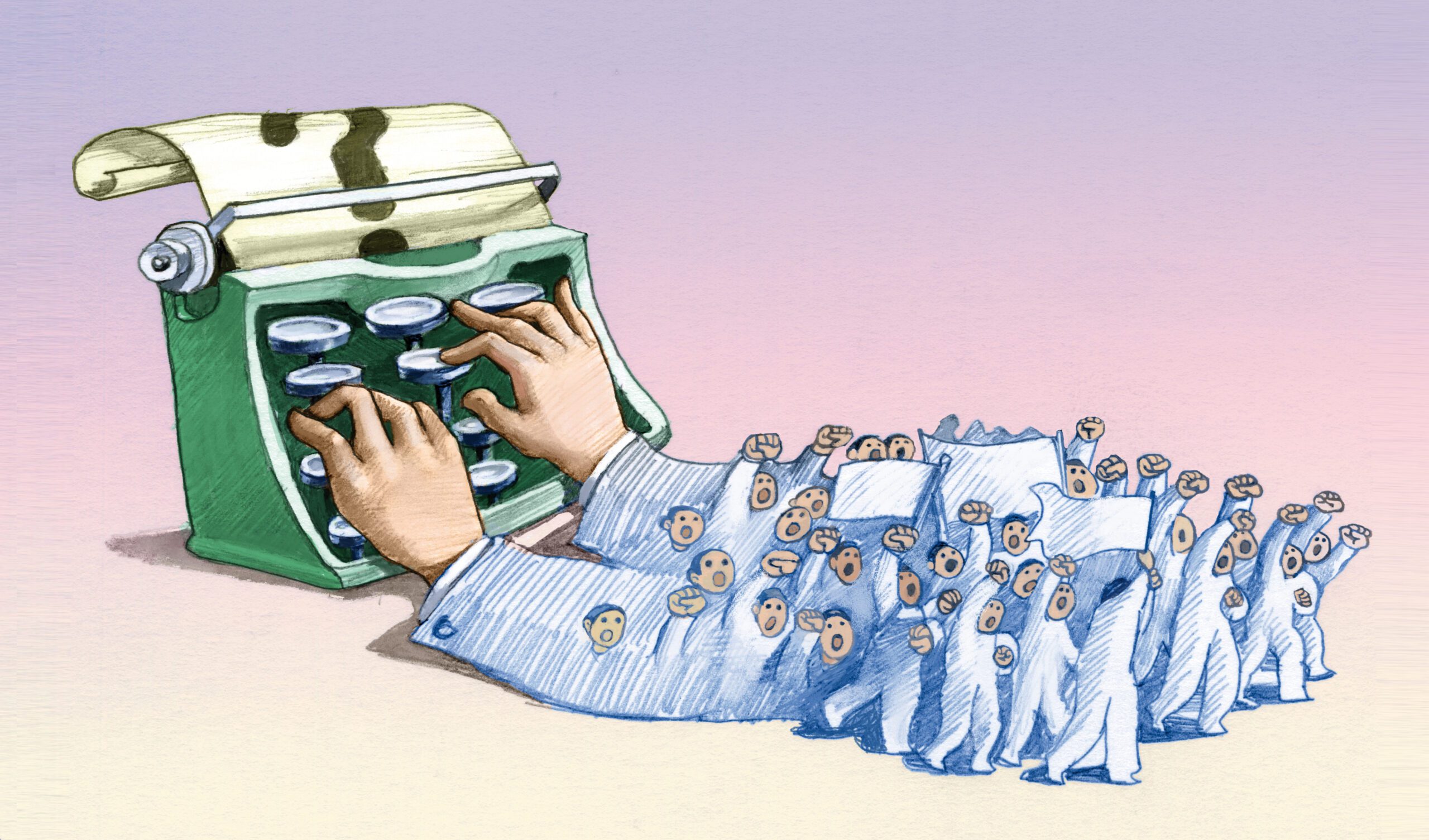
La révolution ne naît pas spontanément
Je suis d’accord pour dire que notre réponse fondamentale à la crise du journalisme devrait être une approche autogérée : nous avons besoin que les organisations médiatiques soient gérées collectivement par le biais de conseils de rédaction. Mais la ligne de conduite appropriée ne me semble pas être de proclamer « je ne m’aligne pas », de constituer une rédaction alternative et d’espérer que cela incite d’autres personnes à agir. Si ce qui est proposé est une révolution du journalisme, il ne suffit pas de critiquer le secteur et de créer des espaces alternatifs (comme le fait Ricardo avec effort et générosité, également en partageant ses connaissances et en cherchant à attirer des financements philanthropiques).
Même si Fumaça et d’autres projets similaires parviennent à créer un paradis de viabilité financière, de puissance éditoriale et de dignité du travail, ce n’est pas par osmose que cette oasis changera les médias. Par conséquent, le résultat concret de la réduction de notre intervention en abandonnant les mouvements ouvriers existants revient à dire à ceux qui travaillent aujourd’hui dans des conditions indignes et plus précaires que les nôtres : « Bonne chance, mais cela ne me concerne pas ». Un « conformisme inadmissible et un manque de solidarité répréhensible ».
Même si la transition vers une organisation autonome des salles de rédaction est urgente, nous devons la rendre possible. Nous y sommes confrontés quotidiennement chez Fumaça : il n’existe aucun cadre législatif ni aucune voie de financement. J’encourage les autres à essayer l’autogestion. Mais il serait irresponsable de dire que tous les médias, en particulier les grandes salles de rédaction qui traitent l’actualité nationale quotidienne, pourraient survivre de cette manière à l’heure actuelle, alors qu’ils perdent de l’argent. Dans le but de révolutionner le journalisme dans son ensemble, notre mécanisme d’intervention sectoriel le plus efficace reste le SinJor.
Je ne vois aucun intérêt à abandonner une institution dont nous pouvons tirer parti, en exploitant sa mémoire, la bonne volonté dont elle jouit et la force de mobilisation qu’elle peut encore exercer sur plus de deux mille associés, ses relations institutionnelles et son accès aux salles de rédaction, en particulier celles qu’elle accompagne dans leurs luttes actuelles. Elle est peut-être plus faible qu’auparavant, mais je ne la considère pas comme mortellement blessée, et je ne pense pas qu’il soit temps de renoncer à y travailler.
Si nous ne voulons pas pousser nos camarades dans le précipice, où ils ne pourront plus payer leurs propres salaires, nous devons travailler de concert pour rendre viable la création de nouvelles salles de rédaction et imposer la démocratisation de celles qui existent déjà. À tout le moins, il faut modifier la législation sectorielle et mettre en place des mécanismes de financement public direct.
Il est essentiel de conférer un pouvoir décisionnel contraignant aux conseils de rédaction élus, y compris en matière de nomination des responsables dans les rédactions hiérarchisées. Il est nécessaire de mettre en place les conditions permettant aux journalistes d’opter pour l’autogestion. Ne serait-ce que pour que les journalistes soient disposés à participer.
Actuellement, je ne suis pas sûr qu’il existe une volonté d’entreprendre une gestion collective et horizontale du journalisme. Encore moins pour les mesures proposées par mon camarade pour y parvenir, comme alternative à mon processus de lobbying réformiste. Si vous voulez évaluer l’ouverture des rédactions à dépasser les « moyens de lutte pacifiques légalisés », il vous suffit de lire la couverture que le journalisme mainstream accorde à tout recours à la violence politique.
On ne peut pas radicaliser une lutte en la menant contre les travailleurs. Soit on mobilise sa classe, soit on prépare un coup d’État avant-gardiste. À l’heure actuelle, c’est ce que représente ici un appel à l’action directe. Il n’y a pas assez de travailleurs intéressés par la prise de force des salles de rédaction, le sabotage des entreprises médiatiques et la destitution des comités de rédaction. Pour avoir un effet radical durable, il faut une organisation collective et le soutien de la classe ouvrière, afin que les journalistes aient les moyens et les fins. Et vous ne pouvez pas non plus laisser de côté ceux qui sont dans des conditions de travail encore pires. Vous ne pouvez pas oublier d’essayer d’améliorer la vie des travailleurs.
Il convient de noter que, dans l’histoire récente, certains journalistes s’opposent même à la grève. Afin de préserver la crédibilité des publications pour lesquelles ils travaillent, ce n’est qu’aujourd’hui, après un an et demi de retards de salaire, que les rédactions de Trust in News ont décidé de mettre un terme à cette situation. Lors de l’organisation de la grève générale, certains journalistes craignaient de nuire à leur employeur : un correspondant sous-traitant d’une chaîne de télévision a demandé en séance plénière si le producteur qui l’employait serait en rupture de contrat s’il ne livrait pas les articles quotidiens commandés. Un autre, qui animait une émission de radio régulière qui serait diffusée le jour de la grève, voulait se joindre à la manifestation, mais préenregistrer l’épisode afin de ne pas décevoir les auditeurs. Lors du congrès, l’approbation de la motion de grève a nécessité l’assurance que l’arrêt de travail n’aurait jamais lieu pendant la campagne électorale à venir, afin de ne pas nuire à l’intérêt public.

Transmettez vos griefs
Au fait, je ne comprends pas la futurologie fataliste de Ricardo Esteves Ribeiro. Il est convaincu que SinJor « ne défend pas et ne défendra pas, de manière systémique et fondamentale, le renversement concret des figures de « l’administration », du « conseil d’administration » et du « leadership ». Ils ne s’opposeront pas intrinsèquement à l’autorité par des actions directes. Ils sont, par essence, capitalistes et réformistes ». De plus, le syndicat « sera toujours un instrument du pouvoir », qui « semble se contenter de servir de béquille au capital », comme il le souligne.
Cette idée présente plusieurs faiblesses. Tout d’abord, le fait que plusieurs présidents de syndicats aient plaidé en faveur de l’autogestion et soutenu les rédactions dans leur transition vers des coopératives. Alfredo Maia l’a fait publiquement, par exemple, avec Comércio do Porto et A Capital. Il a même tenté, en 2010, de faire adopter une législation accordant par défaut aux rédactions la propriété des publications en faillite. Les comités directeurs suivants ont soutenu le même principe : lorsque des entreprises font faillite, ceux qui y travaillent tentent de les reprendre. Cela découle d’une longue tradition d’autorégulation et de résistance collective des journalistes portugais, sous la dictature comme en démocratie. Mais, comme le montre la disparition du Comércio do Porto, il ne suffit pas d’y être favorable. Et pour ceux qui ont passé toute leur carrière au service d’une entreprise de médias, ce n’est pas un acte de foi facile à faire.
Il est juste de noter que cette position n’est pas « systémique et fondamentale ». L’axe central du SinJor n’a en fait pas été la construction d’un journalisme non hiérarchique. Mais cela ne signifie pas que cet objectif soit inatteignable. Il faut être extrêmement pessimiste pour trouver impossible de diriger une organisation composée de nos camarades, des personnes concrètes que nous connaissons, afin qu’elles défendent une cause juste. Pour citer Audre Lorde, en 1981 : « La colère est chargée d’informations et d’énergie. Car la colère entre pairs engendre le changement, et non la destruction, et le malaise et le sentiment de perte qu’elle provoque souvent ne sont pas fatals, mais un signe de croissance. »
Je vous invite à diriger votre colère, camarade, pour nous faire grandir. Apportez vos idées. Et si la classe ne les soutient pas immédiatement, convainquez-la. Proposez un plan de formation à l’autogestion, organisez bénévolement des ateliers sur les modèles décisionnels non hiérarchiques, planifiez des cours d’été sur le financement du journalisme de service public et réfléchissez à des stratégies (légales ou non) qui permettent une gestion collective au-delà de la prise de contrôle de la salle de rédaction. Le syndicat est ce que vous en faites. Donnez-nous votre énergie.
Salutations syndicales,
Nuno Viegas
—
Ricardo Esteves Ribeiro, auteur du texte critiqué ici par Nuno Viegas, a édité le texte que vous venez de lire.

Nuno VIEGAS
A PROPOS DE L’AUTEUR
Nuno Viegas est un podcaster et journaliste d’investigation portugais qui mène des recherches sur les forces de l’ordre et le système pénal, souvent dans le cadre de la législation sur la liberté d’information. Au sein de la publication Fumaça, gérée par ses employés et soutenue par ses membres, il codirige également la collecte de fonds. Bénéficiaire d’une bourse du Pulitzer Center, de l’Alfred-Toepefler-Stiftung et de la Fondation Rosa Luxemburg, son travail a été récompensé par le prix AMI du journalisme contre l’indifférence et le prix des droits de l’homme et de l’intégration de la Commission nationale de l’UNESCO. En 2024, il a été élu au comité directeur du Syndicat des journalistes portugais.